CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
Groupe d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés
 |
Toulouse, le 05 mai 1982 |
NOTE TECHNIQUE
N° 12
( ENQUÊTE 81/07 et 81/09 )
ISSN : 0750-6694
ENQUETE 81/09
RAPPORT D'INTERVENTION DU GEPAN
( JJ. VELASCO )
SOMMAIRE
3. - DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES
3.1. - PHOTOS PRISES PAR LA GENDARMERIE DE V1

1/- VUE D'ENSEMBLE DES DEGATS OCCASIONNES DANS LE CHAMP ENSEMENCE ( terre projetée de 1,70 m à 4 m du point d'impact - 6.10.81 )

2/- VUE DE DESSUS DU TROU FORME DANS LE SOL - DIAMETRE INTERIEUR 15 CM (6.10.81)
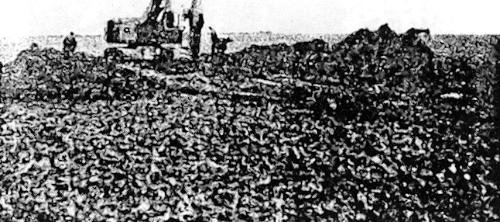
3/- VUE D'ENSEMBLE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT (29. 10. 81)

4/- VUE DES TRAVAUX A LA PROFONDEUR DE 2 METRES (29.10.81)

5/- VUE DES TRAVAUX A LA PROFONDEUR DE 5,5 METRES (29.10.81)

6/- VUE RAPPROCHEE D'UN ARBRE ATTEINT PAR LA FOUDRE DANS LA NUIT DU 3 AU 4 OCTOBRE 1981
3.2. - PHOTOS DU GÉPAN (29.10.81)

7/- VUE GENERALE DU CHAMP DE M. GUILLAUME
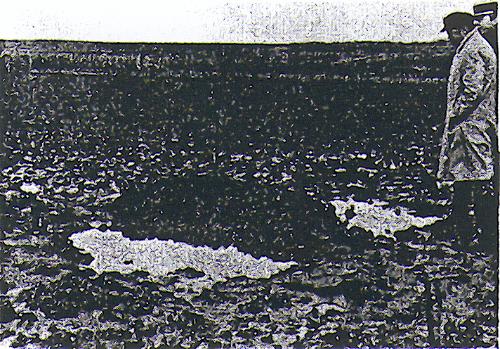
8/- VUE RAPPROCHEE DE LA ZONE PERTURBEE LE 29.10.81
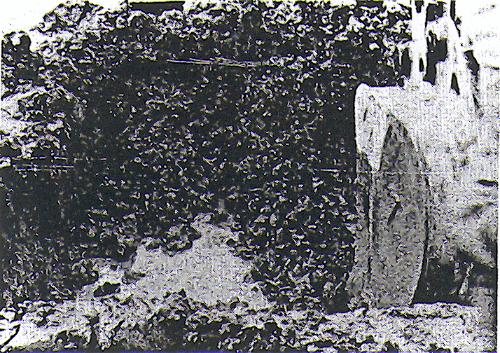
9/- VUE DE LA FOUILLE A 2 M DE PROFONDEUR

10/- VUE GENERALE DU CHANTIER DE FOUILLE

11/- RECHERCHE DE METEORITE DANS LA TERRE EXTRAITE

12/- VUE DE LA FOUILLE A 5,5 M DE PROFONDEUR
4. - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
4.1. - DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES
Le résultat de la fouille n'ayant rien donné quant à la découverte d'une météorite, la recherche d'une solution s'orientait vers la manifestation orageuse, mentionnée par M. GUILLAUME ainsi que par les personnes rencontrées sur les lieux de la fouille et dont des effets concrets étaient visibles par ailleurs ( boeufs et arbres foudroyés ).
Une vérification des conditions atmosphériques locales est venue conforter cette hypothèse.
La station de V4 distante de moins de 50 km nous a fourni les éléments suivants :
de nombreuses averses, parfois violentes, ont été observées dans la région de V4 au cours des journées des 3 et 4 octobre 1981; de fortes rafales de vent les ont accompagnées ( max du 3 = 79 km/h à 22 H 50, max du 4 = 83 km/h à 01 H 10 ) notamment la nuit ;
des manifestations orageuses se sont produites au cours de la nuit du 3 au 4 octobre 1981 ainsi que l'a noté l'observateur de service sur son compte-rendu quotidien.
4.2. - AUTRES RECHERCHES DE DONNÉES
Le GEPAN a essayé de lever définitivement le doute entre l'hypothèse météorite et l'hypothèse coup de foudre, en orientant son enquête vers deux directions : une caractérisation des effets secondaires des chutes de météorites et de foudre, et une détection éventuelle de ces phénomènes par un réseau de surveillance systématique. Cette enquête a été menée à l'occasion de visite du GEPAN dans de nombreux laboratoires, parmi lesquels :
Laboratoire de minéralogie du Muséum d'Histoire Naturelle de PARIS ( M. PELLAS ) ;
CEA-Saclay ( M. HUBERT ) ;
ONERA-Meudon ( M. BOULAY ) ;
CNET-Lannion ( M. HAMELIN ) ;
Institut de Physique du Globe - Saint Maur.
Pour ce qui est de l'affaire de V2, le GEPAN en a retiré les informations suivantes :
-
Caractérisation des effets secondaires des chutes :
Pour ce qui est des météorites, il n'y a pas de règle générale pour la forme du cratère : tout dépend de la qualité du sol. Toutefois, le trou doit être d'un diamètre à peu près constant.
Pour ce qui est de la foudre, la forme et la profondeur peuvent être quelconques, tout dépend du sol. Il peut y avoir vitrification sur les bords ( s'il y a de la silice ) ce qu'on appelle fulgurite ; le courant peut aussi suivre des racines souterraines. De toute façon il n'y a pas eu apparemment d'étude systématique sur cet aspect ( c'est-à-dire les chemins optimaux du courant de décharge dans des milieux cultivés ou en friche ). Les recherches les plus voisines sont celles concernant le foudroiement de certaines installations ( avions, pylônes, antennes ). Les chutes de foudre occasionnent 3 types d'effets un effet de souffle, un rayonnement électromagnétique et la génération d'un champ magnétique induit par la décharge. Le rayonnement électromagnétique est à longue portée et permet de déceler la décharge à des dizaines de kilomètres de distance. Les effets de souffle et de champ magnétique induit sont plus locaux et peuvent conduire à des traces rémanentes ( par exemple l'inversion du champ magnétique local en un point du plateau de Gergovie ). Encore faut-il que l'environnement s'y prête ( matériau magnétisable par exemple ). Là non plus nous n'avons pas trouvé d'étude générale sur ces sujets ( action sur des végétaux, par exemple, des effets de souffle ou de champ magnétique intense et bref ).
-
Détection systématique :
La détection systématique des météorites est faite dans certains pays à l'aide d'un réseau de stations équipées de caméras optiques à grands champs et à long temps de pause. C'est le cas en Allemagne, en Tchécoslovaquie, aux USA, etc. Actuellement en France il n'y a aucun système de ce type et il n'est pas possible de confirmer par ce biais le passage d'un météorite.
Pour ce qui est du repérage des éclairs, il est fait automatiquement par les caméras optiques évoquées ci-dessus pour le repérage des météores. Cependant, il existe aussi des installations spécifiques mesurant les variations de champs électromagnétiques entre 10 MHz et 100 MHz qui permettent, par triangulation, de localiser les décharges. De telles installations existent aux USA, en Allemagne, en Norvège, en Suède, etc. Là encore, il se trouve que la France ne s'est pas dotée d'un tel réseau de détection systématique. Les systèmes de protection, détection, prévision restent dans le cadre géographique et administratif des utilisateurs concernés ( Météorologie Nationale, EDF, CNET, CEA, Aérodromes, etc. ). Là encore il est très difficile de confirmer par détection directe, l'hypothèse d'une chute de foudre dans un lieu donné.
5. - CONCLUSIONS
L'ensemble des informations recueillies sur place à V2, et au cours des opérations de collectes de renseignements complémentaires, oriente l'analyse vers une hypothèse de chute de foudre qui dans la nuit du 3 au 4 octobre aurait frappé le champ de M. GUILLAUME en y creusant un trou profond de 5 à 6 mètres au moins.
Cependant, l'enquête menée sur ces événements aura été révélatrice à bien des égards : malgré les efforts déployés, il n'a pas été possible d'accéder à un niveau de preuves directes et définitives concernant l'hypothèse finale. Pourtant, il s'agit bien simplement dans ce cas de phénomènes naturels connus ( tout au moins dans leurs grands principes ), exempts de nos jours de toute composante mystique ou passionnelle. Ceci n'empêche pas que l'analyse scientifique y reste assez limitée.
Plus révélateur encore est peut-être le fait que l'enquête sur ce coup de foudre a été suscitée par un témoignage privé, et que ce témoignage a d'abord orienté les chercheurs vers une hypothèse finalement fausse.
Peut-être faut-il y voir l'indice d'une communauté de problème entre des domaines de recherche différents : les phénomènes rares, fugitifs, imprévisibles et/ou difficilement reproductibles ( dont les météorites et les décharges atmosphériques ) donnant lieu à des informations sous forme de témoignages humains, avec tout ce que cela comporte d'incertain et d'imprécis. D'un autre côté, les mesures quantifiées faites sur eux exigent des structures de détections complexes. D'ailleurs même si ces structures existent, même si une étude expérimentale in situ peut un jour être développée ( comme pour la foudre, par exemple ), les témoignages spontanés à leur sujet et les enquêtes auxquels ils conduisent gardent un intérêt certain pour peu que des critères d'analyse rigoureuse soient respectés.
Peut-être faut-il voir là, dans cette problématique des phénomènes rares, une meilleure appréciation du champ d'application de la méthodologie générale choisie par le GEPAN dans son schéma tétraédrique.
FIN
© CNES