CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
Groupe d'Etude des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés
 |
Toulouse, le 15 février 1980 CT/GEPAN - 050 |
NOTE D'INFORMATION N°1
Observations de phénomènes atmosphériques
anormaux en U.R.S.S.
- Analyse statistique -
( MM. GUINDILIS, MENKOV & PETROVSKAIA )
Présentation
par Alain ESTERLE
Le document que nous éditons ici constitue la première Note d'information du GEPAN et il succède à la première Note Technique qui fut produite en octobre 1979.
Conformément à ce qui fut annoncé, les Notes d'Information différent des
Notes Techniques en ceci qu'elles sont gratuites et que leur contenu ne présente
pas des travaux ou des recherches développés au GEPAN ou en collaboration avec
le GEPAN.
Il s'agit plutôt de travaux menés indépendamment du GEPAN et dont la
connaissance semble utile, voire capitale, pour tous ceux qui
s'intéressent de près à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Le document que nous présentons dans cette première Note d'Information nous
fut communiqué par leurs auteurs.
Il est remarquable à plus d'un titre :
la rigueur de la méthodologie employée est sans doute un exemple :
aucune ambiguïté n'est éludée ou passée sous silence.
Au contraire, des hypothèses de travail sont clairement formulées et mises en oeuvre ;les résultats obtenus sont comparés aux résultats connus que des études antérieures avaient pu produire à partir d'autres fichiers, construits indépendamment dans d'autres pays et/ou à d'autres époques.
Cette démarche comparative est très intéressante.
En effet, un fichier donné de narration d'observations contient simultanément la trace des éventuels phénomènes observés, celle de l'échantillon des témoins des observations et enfin la marque, la signature du circuit suivi par l'information des témoins jusqu'au fichier.
Pour les résultats statistiques obtenus sur un fichier donné, il est difficile de savoir ce qui relève de chacun des trois aspects.
Par contre, la difficulté peut être tournée en comparant les résultats de fichiers relevant d'échantillons de témoins différents et de circuits d'information distincts.
A ce sujet, le GEPAN dispose d'un fichier original constitué des procès-verbaux de la Gendarmerie nationale.
Son étude statistique est en cours et les résultats seront comparés à ceux du fichier de POHER, du fichier de ZIGUEL et celui de HYNEK et enfin celui de SAUNDERS, ... Ceci sera le sujet d'une prochaine Note Technique ;enfin, ce travail a été effectué à MOSCOU, par des chercheurs et ingénieurs soviétiques sur des données d'observations faites en U.R.S.S.
Il s'agit d'un travail bénévole et spontané.
Il faut cependant noter que ce document a reçu l'approbation pour publication de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.
Peut-être faut-il y voir la preuve que les réticences souvent remarquées au sein de la Communauté Scientifique tenaient moins au fond qu'à la forme :
ces réticences provenaient moins du sujet traité que des "méthodes" d'analyses et de réflexions employées.
Il n'y a pas de sujet indigne de la Science, il n'y a que des méthodes indignes d'elle.
Ce document est édité afin que chacun puisse disposer de ces éléments pour
poursuivre ses études.
Afin d'en faciliter le maniement, nous avons pris la liberté d'adjoindre une
table des matières au début du document, ainsi qu'une liste des tableaux et des
figures.
Cependant, nous avons gardé les figures rassemblées à la fin, comme dans
l'original.
Il nous reste à souhaiter que les études de Phénomènes Aérospatiaux
Non-identifiés vont se développer en U.R.S.S. et dans tous les pays pour
clarifier toujours davantage ce problème grâce à la multiplicité des sources
d'information et des approches indépendantes et rigoureuses.
ACADEMIE DES SCIENCES D'U.R.S.S.
- INSTITUT D'ETUDES COSMIQUES -
Moscou - 1979
Pr - 473
OBSERVATIONS DE PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES ANORMAUX EN U.R.S.S.
- ANALYSE STATISTIQUE -
Par :
L.M. GUINDILIS
D.A. MENKOV
I.G. PETROVSKAIA
OBJET : Résultats du traitement d'un premier choix de données d'observation.
Document présenté pour impression par le membre correspondant de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S., N.S. KARDACHEV.
Document traduit par Madame Marie-Jeanne FERRET.
Cet ouvrage est publié sur décision du Département de Physique générale et d'Astronomie du Présidium de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S.
La préparation du traitement et la mise en forme des documents d'observation de base ont été faits par I.G. PETROVSKAIA (IKI).
L'étude statistique des documents, la systématisation et le calcul des erreurs de données ont été réalisés par D.A. MENKOV ( Institut d'Ingénieur en Physique de MOSCOU ).
La rédaction scientifique générale de ce document a été réalisée par L.M.
GUINDILIS ( Institut Astronomique d'Etat Sternberg ).
Il est également l'auteur des points 3.3. et 14 ( considérations ).
Institut d'Etudes Cosmiques
Académie des Sciences
Publication IKI-AN-URSS-1979
TABLE DES MATIÈRES
- INTRODUCTION -
- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES DOCUMENTS DE BASE
- CIRCONSTANCES DE L'OBSERVATION
- OBSERVATEURS ET TÉMOINS DE L'OBSERVATION
- RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES DANS L'ESPACE
- RÉPARTITION DES PHENOMENES DANS LE TEMPS
- CLASSIFICATION DES PHENOMÈNES, DU TYPE DES OBJETS
- DURÉE DES ÉVÈNEMENTS
- STRUCTURE DES OBJETS ET CARACTÈRES DE LEUR LUMINESCENCE
- DIMENSIONS ANGULAIRES DES OBJETS
- CARACTÉRISTIQUES DU MOUVEMENT DES OBJETS
- ESTIMATION DES VALEURS LINÉAIRES
- EFFETS ET PHÉNOMÈNES ACCOMPAGNANTS
- DATES AVEC UN GRAND NOMBRE DE CAS D'OBSERVATIONS
- CONSIDÉRATIONS
Cet ouvrage comprend l'analyse statistique d'informations présentées dans 256 rapports d'observation de phénomènes atmosphériques anormaux, en U.R.S.S.
Cette analyse permet de mettre en évidence certaines régularités statistiques
de ces phénomènes.
Les caractéristiques de temps et certaines autres données sont analogues à celles
obtenues par d'autres auteurs ( dans d'autres pays ).
Ceci permet de conclure qu'il existe une classe
déterminée de phénomènes présentant des propriétés statistiques stables.
Il est actuellement prématuré de juger de la nature de ces phénomènes à partir
des données obtenues.
Il est indispensable de développer une méthode pour obtenir des données plus
fiables, élargir l'ensemble d'informations de base utilisé, et approfondir
l'analyse statistique de certains paramètres du phénomène.
LISTE DES TABLEAUX
- TABLEAU N° 1 : Caractéristiques de la nébulosité
- TABLEAU N° 2 : Nombre de témoins
- TABLEAU N° 3 : Catégories
- TABLEAU N° 4 : Spécialité de l'observateur
- TABLEAU N° 5 : Groupe professionnel
- TABLEAU N° 6 : Nombre d'observations par jour
- TABLEAU N° 7 : N° des cas où intervient la redondance
- TABLEAU N° 8 : Forme des objets
- TABLEAU N° 9 : Détails extérieurs
- TABLEAU N° 10 : Détails intérieurs
- TABLEAU N° 11 : Caractère de la brillance
- TABLEAU N° 12 : Intensité de l'éclat
- TABLEAU N° 13 : Couleur des objets
- TABLEAU N° 14 : Mesures angulaires
- TABLEAU N° 15 : Vitesse angulaire
- TABLEAU N° 16 : Trajectoire des objets
- TABLEAU N° 17 : Direction d'éloignement des objets
- TABLEAU N° 18 : Effets accompagnants
- TABLEAU N° 19 : Observations du 17.07.67
- TABLEAU N° 20 : Observations du 19.09.67
- TABLEAU N° 21 : Observations du 18.10.67
LISTE DES FIGURES
- FIGURE N° 1 : Point d'observation, partie européenne d'URSS
- FIGURE N° 2 : Point d'observation, partie asiatique d'URSS
- FIGURE N° 3 : Répartition en latitude et longitude
- FIGURE N° 4 : Répartition en longitude
- FIGURE N° 5 : Répartition en latitude
- FIGURE N° 6 : Répartition selon les années
- FIGURE N° 7 : Répartition selon les mois (échantillon complet)
- FIGURE N° 8 : Répartition selon les mois (sous-échantillons)
- FIGURE N° 9 : Répartition selon les jours (année 1967)
- FIGURE N° 10 : Répartition selon les heures locales et solaires
- FIGURE N° 11 : Répartition selon les heures locales et solaires (comparaison)
- FIGURE N° 12 : Répartition selon les heures suivant les saisons
- FIGURE N° 13 : Répartition selon les heures sidérales
- FIGURE N° 14 : Répartition selon les heures en temps universel
- FIGURE N° 15 : Répartition selon la durée
- FIGURE N° 16 : Répartition selon la durée (comparaison)
- FIGURE N° 17 : Répartition selon la durée et le type
- FIGURE N° 18 : Répartition selon la direction du mouvement
- FIGURE N° 19 : Répartition selon la direction et le type
- FIGURE N° 20 : Points d'observation du 17.07.67
- FIGURE N° 21 : Points d'observation du 19.09.67
- FIGURE N° 22 : Points d'observation du 18.10.67
INTRODUCTION
Cette analyse a été faite à partir de la documentation d'un premier ensemble
de rapports sur des phénomènes atmosphériques et spatiaux anormaux, observés
en URSS (*).
(*) Les rapports de cet échantillon de données d'observation
ont été collectés et aimablement mis à notre disposition par F.J. ZIGUEL.
Afin de faciliter le traitement, les rapports d'observation ont été mis sous
forme de code développé spécialement à cet effet.
Les rapports mis en forme, reportés sur des cartes perforées K-5, représentent
l'ensemble initial du Catalogue Général (OK) préliminaire des phénomènes
atmosphériques et spatiaux anormaux.
Les rapports utilisés constituent un échantillon du Catalogue Général préliminaire.
Ci-dessous, on examine les caractéristiques statistiques de cet échantillon.
Dans cet ouvrage, nous utilisons le terme "Phénomènes Atmosphériques
et Spatiaux Anormaux", ou bien "phénomènes atmosphériques anormaux".
Parfois, on utilise dans le texte, dans le même sens, les termes abrégés
"phénomènes anormaux" ou "objets anormaux".
Le terme NLO (OVNI) utilisé auparavant nous parait moins adéquat pour ce travail
car il implique une certaine interprétation du phénomène observé.
Cependant, dans certains cas, par exemple dans des références ou lorsqu'on
examine d'autres travaux, nous utilisons également ce terme dans notre travail.
Retour au SOMMAIRE
1. CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE DES DOCUMENTS DE BASE
Ce document comprend 207 rapports dans lesquels sont présentés 256 cas
d'observation de phénomènes ou d'objets anormaux ( on a attribué à ces cas
des numéros dans le Catalogue Général préliminaire de 0001 à 0253 et de 0462 à
0464 ) (**).
(**) D'après les indications données par lettre par M.
GUINDILIS, ce choix fut chronologique ( Note du GEPAN ).
Ils comprennent :
| - Observations terrestres : | 242 cas |
| - Observations à bord d'un avion : | 13 cas |
| - Observations en mer, à bord d'un vaisseau : | 1 cas |
Parmi ceux-ci, il y a 11-12 cas d'observation à courte distance.
Dans cette catégorie, nous comprenons les cas où, d'après l'estimation de
l'observateur, la distance de l'objet était de l'ordre de 100 ou quelques
centaines de mètres ( une erreur est possible dans plusieurs cas, mais
l'ordre de grandeur reste apparemment exact ), soit des cas où la distance
n'est pas indiquée mais où l'observateur distingue des détails à l'il nu,
perçoit un certain effet, observe un objet sombre la nuit, etc...
Dans le cas d'observations à bord d'un avion, nous classons dans la catégorie "proche", celles faites à une distance de l'ordre de 10 km, ainsi que dans le cas d'une manuvre de l'objet par rapport à l'avion ou en présence d'effets subis.
La plus grande majorité des observations ( 97% ) sont des observations
ordinaires à l'il nu.
Dans 9 cas, on a utilisé des équipements optiques ( jumelles dans 4 cas,
lunette dans 4 cas, télescope dans 1 cas ).
Il y a deux observations d'enregistrement par radar.
De plus, dans l'un des cas ( OK-0218 ), il
y a eu simultanément observation visuelle et enregistrement radar.
Les rapports comprennent les descriptions orales du phénomène observé avec
indication des circonstances de l'observation.
Dans 50 cas, il y a des dessins, dans 3 cas des photographies ont été prises.
Pour 16 cas, il y a dans le document initial une référence à l'existence d'un document de service ( lettre de service : 2 cas, télégramme de service : 8 cas, rapport de service : 5 cas, article dans une revue : 1 cas )(*). (*) Document de service désigne ici un document administratif interne ou non (N.D.T.).
Les auteurs de la plupart des rapports indiquent leur adresse, domicile ou téléphone de service, communiquent leur lieu de travail et les fonctions qu'ils y occupent.
Retour au SOMMAIRE
2. CIRCONSTANCES DE L'OBSERVATION :
CONDITIONS METEO
- VISIBILITÉ DES OBJETS CÉLESTES
Pour l'analyse des cas concrets, la connaissance des conditions météorologiques
a une grande signification.
Malheureusement, dans la majorité des rapports, ces données sont totalement
absentes.
Pour 83 cas d'observation ( sur les 256 considérés ), soit dans 32% des
cas, on a des données sur la nébulosité.
Ces données sont présentées dans le tableau n°1.
| CARACTÉRISTIQUES DE LA NÉBULOSITÉ | Nombre de cas | % du Nombre total de cas |
| - Absence de nébulosité (temps clair) | 61 | 24 % |
| - Présence de nébulosité A savoir :
|
21 | 8 % |
| - Données manquantes | 174 | 68 % |
| TOTAL | 256 | 100 % |
- TABLEAU N° 1 -
Retour au SOMMAIRE
La visibilité des objets célestes pendant l'observation présente également un intérêt.
On voyait :
- le soleil dans 28 cas,
dont :- 4 cas au lever,
- 15 cas au coucher
- la lune dans 19 cas,
- des étoiles dans 38 cas.
Pour 177 cas, on ne parle pas des objets célestes vus.
Retour au SOMMAIRE
3. OBSERVATEURS ET TÉMOINS DES OBSERVATIONS
Nous appelons observateurs, les personnes ayant fait l'observation.
Dans la grande majorité des cas ( 214, c'est à dire 86% des cas ),
ils ne sont pas les auteurs des rapports.
Dans certains cas, le rapport est écrit avec les mots de l'observateur, par une
autre personne, ou bien à partir de documents manuscrits ( 26 cas=10% ).
Dans 8 cas ( 3% ), on ne sait pas clairement si le rapport a
été écrit par l'observateur lui même ou non.
Nous appelons témoins ( ou témoins oculaires ) les observateurs et les personnes au sujet desquels d'après les rapports, on sait qu'ils étaient également présents et qu'ils ont observé le phénomène décrit.
Retour au SOMMAIRE
3.1. NOMBRE DE TÉMOINS DU PHÉNOMÈNE
Le nombre de témoins est caractérisé par le tableau n°2.
Il y a 34% d'observateurs isolés.
Dans 64% des cas, il y a plus d'un témoin.
Ceci est supérieur aux données de l'étranger (Ref. 1).
Le pourcentage des observations "de masse" est important ( 15% ).
Dans cette catégorie, nous classons les cas où les témoins oculaires du phénomène
ont représenté des groupes importants spectateurs d'un cinéma en plein air,
habitants d'un village, nombreux habitants d'une ville, etc...
Ce sont des dizaines, des centaines et parfois même des milliers de gens.
| NOMBRE DE TÉMOINS | Nombre DE CAS D'OBSERVATION | % DU Nombre TOTAL DE CAS |
| 1 témoin | 87 | 34 % |
| 2 témoins | 39 | 15 % |
| 3 témoins | 13 | 5 % |
| 4 témoins | 9 | 3,5 % |
| "quelques" | 70 | 27,5 % |
| observation de masse | 38 | 15 % |
| TOTAL | 250 | 100 % |
- TABLEAU N° 2 -
Retour au SOMMAIRE
3.2. CATÉGORIES DES OBSERVATEURS
Les catégories des observateurs sont présentées dans le tableau n°3 d'après leur lieu de résidence et le caractère de leur activité.
Le nombre total de cas ( voir tableau n°3 ) est égal à 259, car
trois cas ( OK-208, OK-126 et OK-259 ) sont pris en compte deux fois
dans la mesure où les témoins oculaires se trouvent dans deux catégories
différentes.
Le pourcentage est pris à partir du nombre total de cas, égal à 256.
| Catégories | Nombre de cas observés | % du Nombre total des 256 cas |
| - Indigènes du pays | 147 | 58 % |
| - Gens de passage dont :
|
57 | 22 % |
| - Personnes en voyage dont :
|
28 | 11 % |
| - Personnes dans des stations d'observation dont :
|
11 | 4 % |
| - Personnes en service militaire, lors de l'exécution d'une opération de service | 5 | 2 % |
| - Non mentionné, inconnu | 11 | 4 % |
| TOTAL | 259 | 101 % |
- TABLEAU N° 3 -
Retour au SOMMAIRE
3.3. RÉPARTITION PAR SPÉCIALITÉS (*)
(*) Le terme "spécialité" désigne l'activité professionnelle - (N.D.T.) -
La répartition du nombre de cas selon les spécialités des observateurs est
présentée dans le tableau n°4.
Dans 134 cas, sur les 256 cas d'observation, la spécialité des témoins oculaires
n'est pas indiquée.
Dans 122 cas ( 48% ), la spécialité est présentée pour 130 témoins
oculaires ayant participé à l'observation.
La répartition de ces témoins d'après leur spécialité est présentée ci-dessous.
| SPÉCIALITÉ DE L'OBSERVATEUR | Nombre d'observateurs | (1) |
| Scientifiques dont :
|
33 | 25% |
| Ingénieurs | 23 | 17,5% |
| Aviateurs | 14 | 11% |
| Laborantins/techniciens | 9 | 7% |
| Enseignants | 9 | 7% |
| Étudiants | 8 | 6% |
| Personnes en études | 8 | 6% |
| Militaires | 8 | 6% |
| Médecins | 5 | 4% |
| Activités culturelles | 5 | 4% |
| Ouvriers | 4 | 3% |
| Fonctionnaires administratifs | 2 | 1,5% |
| Prestations de services | 1 | 1% |
| Marins | 1 | 1% |
| TOTAL | 130 | 100% |
- TABLEAU N° 4 -
(1) : Pourcentage du nombre total de témoins de la spécialité mentionnée.
Retour au SOMMAIRE
Le pourcentage important d'observateurs présentant une certaine qualification
attire l'attention :
scientifiques, ingénieurs, aviateurs ( 52% ).
A l'opposé d'une erreur largement répandue, parmi les observateurs, il y a un
pourcentage très important d'astronomes ( 7,5% du nombre total des témoins
dont la spécialité est mentionnée, et 30% du chiffre des scientifiques ).
Considérant la part relative des personnes de spécialités différentes dans l'effectif total de la population du pays, on peut citer un coefficient caractérisant "l'activité" (*) des différents groupes professionnels :
K = gamma( ni / Ni )
où :
- ni : nombre d'observateurs d'une profession donnée
- Ni : nombre total de personnes de cette profession
- gamma : multiplicateur normalisant
(*) "L'activité" désigne ici la propension statistique de la catégorie désignée à fournir un rapport d'observation (N.D.T.).
Les valeurs Ni pour les différents groupes professionnels sont pris conformément
aux résultats du recensement de l'Union de 1970 (Ref. 2).
Pour la détermination du coefficient d'activité, ce n'est pas la valeur absolue Ni
qui joue un rôle, mais le rapport entre ces valeurs.
Nous utilisons les données du recensement de 1970 car c'est celui qui se trouve le
plus près de l'année 1967, qui est d'une contribution essentielle dans l'échantillon
étudié.
Les données sur le nombre d'étudiants et de personnes faisant des études sont prises
dans l'Annuaire de la Grande Encyclopédie Soviétique (Ref. 3).
Les données sur le nombre d'astronomes est pris en accord avec A.S. CHAROV
( elles ont été obtenues avec le Fichier du Conseil Astronomique de l'A.N.
URSS et d'autres documents ).
Les résultats sont présentés dans le tableau n° 5.
Le tableau illustre très clairement le coefficient élevé du secteur d'activités
scientifiques, en particulier d'astronomes, ce qui indique que l'opinion largement
répandue disant que parmi les observateurs il y a surtout des gens non expérimentés,
et qu'il n'y a soit disant pas de rapports de spécialistes, est tout à fait fausse.
Déjà en 1966, J. HYNEK(**) attirait l'attention sur l'erreur de ce point de vue
(Ref. 4).
(**) Rappelons que J. HYNEK, conseiller scientifique des
commissions militaires américaines sur le sujet de 1952 à 1969, est lui même
astronome professionnel (NDG).
| GROUPE PROFESSIONNEL | EFFECTIF DU GROUPE (millions d'h.) | Nombre OBSERVATEURS DE CE GROUPE | COEFFICIENT D'ACTIVITE |
| Toute population d'un âge supérieur à 9 ans | 196,5 | 130 | 1,0 |
| Scientifiques dont : |
0,456 | 33 | 110 |
| . astronomes | 0,002 | 10 | 7500 |
| . ingénieurs | 2,49 | 23 | 14 |
| Médecins | 0,566 | 5 | 13 |
| Techniciens/laborantins | 1,71 | 9 | 8 |
| Activités culturelles | 1,23 | 5 | 6 |
| Enseignants d'Institut Supérieurs et d'écoles | 3,34 | 9 | 4 |
| Etudiants | 4,3 | 8 | 3 |
| Prestations de services | 1,6 | 1 | 0,9 |
| Personnes en études | 49,0 | 8 | 0,2 |
| Ouvriers | 66,3 | 4 | 0,1 |
- TABLEAU N° 5 -
Retour au SOMMAIRE
3.4. RÉPÉTITION D'OBSERVATIONS DE PHÉNOMÈNES ANORMAUX PAR UN MÊME TEMOIN
La plupart des observateurs ont vu les phénomènes anormaux une fois.
Cependant, il y a des témoins qui les ont observés pendant des intervalles de temps
différents plusieurs fois.
Parmi ceux-ci, 16 témoins ont fait l'observation 2 fois, 6 l'ont faite 3 fois et
2 l'ont faite plus de 3 fois.
Retour au SOMMAIRE
4. RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES DANS L'ESPACE
Les points où ont été observés des phénomènes sont reportés sur les cartes
( fig. 1&2 ).
Dans l'ensemble, ils occupent tout le territoire de l'Union Soviétique.
Cependant, à certaines périodes, on observe une "activité élevée" dans certaines
régions.
Ainsi, en 1967, a eu lieu une "activité élevée" dans les régions du CAUCASE NORD,
du DOMBASS et dans celle de ROSTOV.
Dans le territoire asiatique de l'Union Soviétique ( sans le CAUCASE )
prédominent des observations faites dans la période de 1957-1966.
Pour 1960, le tiers des observations tombe sur la partie européenne du
territoire de l'URSS et les deux tiers sur la partie asiatique.
Il va de soi qu'on ne peut pas considérer ceci comme des lois fermement établies
( la statistique est trop pauvre ), cependant, on remarque
apparemment certaines tendances à la variation de ces régions "d'activité" avec
le temps.
Une confirmation complémentaire de cette déduction est la répartition spatiale des
phénomènes obtenue selon d'autres échantillons.
En figure 3, est présentée la répartition bidimensionnelle du nombre de cas
d'après la longitude et la latitude.
En figure 4, la répartition unidimensionnelle du nombre de cas d'après la longitude,
et en figure 5, la répartition selon la latitude.
Il se dégage nettement un maximum longitudinal pour la longitude 35-45°.
La répartition en latitude est plus homogène, cependant ici aussi on dégage deux
maximums : aux latitudes 44-46° et 48-50°.
Retour au SOMMAIRE
5. RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES DANS LE TEMPS
5.1. RÉPARTITION SELON LES ANNÉES ET LES MOIS DE L'ANNÉE
L'échantillon étudié comprend des cas d'observation d'objets anormaux de 1923 à 1974, dont :
| - jusqu'à 1957..... | 14 cas... | soit 5,5 % |
| - de 1957 à 1965..... | 36 cas... | soit 14 % |
| - en 1967..... | 194 cas... | soit 76 % |
| - de 1968 à 1974..... | 12 cas... | soit 4,5 % |
En figure 6, sont présentées plus en détail les données de répartition selon
les années.
Celles-ci ne reflètent qu'indirectement l'activité réelle du phénomène dans le
temps.
Ainsi, la brusque augmentation du nombre de rapports en 1967 est sans doute liée
à une émission de la télévision centrale parlant du phénomène OVNI, invitant à
communiquer les observations de phénomènes semblables.
En même temps, à en juger d'après les données de l'étranger (5,6), en 1967, on
observe effectivement un certain accroissement de l'activité OVNI.
De façon analogue, la brusque baisse du nombre de rapports après 1968 est
apparemment liée aux déclarations critiques de la presse centrale
( "PRAVDA" - 1968, 29.P ) où le problème des OVNI est qualifié de non
scientifique.
A notre avis, l'existence d'observations d'objets anormaux avant 1957 est tout à
fait essentielle.
En plus des données correspondantes à l'étranger, ceci indique, au moins, que tous
les cas d'observation de tels objets ne peuvent être liés à des équipements
techniques habituels ( connus ) ou à des expériences de l'espace cosmique.
La répartition des observations selon les mois de l'année est présentée en
figure 7.
Les histogrammes ont été faits sans tenir compte et en tenant compte d'une
redondance possible provenant de l'obtention de plusieurs rapports indépendants
d'un seul et même phénomène ( cf. § 5.2 ).
Comme on le voit, l'effet de redondance ne déforme pratiquement pas l'image de la
répartition.
"L'activité élevée" en été/automne peut être due au fait que c'est une période
plus propice aux observations.
Cependant, pour la courbe se rapportant à 1967, l'attention se porte sur le faible
nombre de cas d'observation ayant lieu en juin, et également sur la nette asymétrie
printemps/automne.
Ces particularités de répartition se répètent pour tout l'échantillon dans la
mesure où la majorité des cas de celui-ci se rapporte à 1967.
La répartition obtenue pour les autres années, sans 1967, est beaucoup plus
symétrique (fig. 8a).
Retour au SOMMAIRE
5.2. RÉPARTITION DES PHÉNOMÈNES SELON LES JOURS DE 1967
La répartition des phénomènes selon les jours pour 1967 est présentée en
figure 9.
Sur les 70 jours désignés comme date d'observation, 24 présentent plus d'une
observation de phénomène dans la journée.
Il s'agit d'observations indépendantes de phénomènes faites par des gens
différents à des endroits différents ( dans la plupart des cas, en des
points géographiques distincts ).
Au total, pour 70 jours, on a observé 157 phénomènes ( en moyenne 2,2
phénomènes par jour ).
Les données sur le nombre d'observations ( d'événements ) par jour
sont présentées dans la tableau 6.
| NOMBRE D'OBSERVATIONS (phénomènes) PAR JOUR | CAS D'OBSERVATIONS AVEC OU NON DATE PRÉCISE | CAS D'OBSERVATIONS AVEC DATE PRÉCISE | ||
| Nombre de | Nombre de | |||
| jours | phénomènes | jours | phénomènes | |
| 1 | 46 | 46 | 35 | 35 |
| 2 | 7 | 14 | 5 | 10 |
| 3 | 5 | 15 | 4 | 12 |
| 4 | 4 | 16 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 6 | 1 | 6 | - | - |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 9 | - | - | 1 | 9 |
| 10 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 12 | 1 | 12 | - | - |
| TOTAL | 70 | 157 | 53 | 117 |
- TABLEAU N° 6 -
Répartition des phénomènes selon les jours en 1967
Retour au SOMMAIRE
Ainsi, sur 157 évènements, 111 ( soit 71% ) se rapportent à des cas
où il a été observé plus d'un événement par jour.
Pour les jours où la date est indiquée avec précision, les chiffres correspondants
sont : 82 évènements sur 117 ( soit 70% ).
Pour une série de cas les évènements se rapportant à une même date ont été
observés à peu près au même moment à des points distants entre eux de pas plus
de quelques centaines de kilomètres.
Ceci permet de supposer que nous avons affaire à des observations indépendantes
d'un seul et même objet ou phénomène.
Dans ce cas, la prise en compte des données d'après tous les rapports d'observations
peut impliquer des déformations dans les répartitions statistiques obtenues à cause
de la redondance.
Dans la mesure où à partir des documents que nous possédons, sans une analyse
complémentaire, il n'est pas possible d'indiquer précisément combien d'objets ont
été observés pour chaque jour concret, nous présenterons dans cette étude aussi
bien les répartitions statistiques selon tous les rapport sans redondance que les
répartitions "corrigées" en tenant compte des redondances.
Dans cette correction on a supposé que toutes les observations, coïncidant en
date et proches dans l'espace se rapportaient à un même objet.
C'est bien sûr une hypothèse majorante. Certaines de ces observations
"coïncidentes" peuvent se rapporter à des objets différents.
C'est pourquoi on peut affirmer que les répartitions réelles se situeront entre
les courbes tracées sans tenir compte et en tenant compte de la redondance.
Le procédé de prise en compte de la redondance est mentionné à
part pour chaque répartition concrète.
Ci-dessous, on présente les numéros des cas pour lesquels on tient compte de l'effet de la redondance :
| DATE D'OBSERVATION | N° DES CAS SELON LE CATALOGUE GÉNÉRAL PRÉLIMINAIRE |
| 19.04.1967 | 0201, 0202, 0203, 0225, 0231 |
| 17.05.1967 | 0119, 0121, 0123, 0124 |
| 17.07.1967 | 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0104, 0221, 0222, 0224, 0226, 0229 |
| 18.07.1967 | 0204, 0205 |
| 19.07.1967 | 0127, 0178 |
| 27.07.1967 | 0016, 0036, 0129 |
| 31.07.1967 | 0128, 0227 |
| 08.08.1967 | 0038, 0039, 0100, 0107, 0228 |
| 19.09.1967 | 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064 |
| 13.10.1967 | 0191, 0192, 0193 |
| 18.10.1967 | 0022, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0106 |
| 28.10.1967 | 0033, 0066, 0088, 0089 |
| 03.11.1967 | 0213, 0462 |
| 14.11.1967 | 0199, 0236 |
| 03.12.1967 | 0212, 0214, 0215, 0216, 0217, 0463, 0464 |
| 19.12.1967 | 0246, 0247, 0248 |
- TABLEAU N° 7 -
N° des cas pour lesquels on tient compte de l'effet de redondance
Retour au SOMMAIRE
5.3. RÉPARTITION DES ÉVÉNEMENTS AU COURS DE LA JOURNÉE
Dans la plupart des cas ( 207 sur 256, soit 81% ) les témoins
communiquent l'heure de l'observation du phénomène.
En figure 10, sont présentés les histogrammes de répartition du nombre de cas
d'observations en fonction de l'heure locale légale et solaire moyenne.
Par heure locale légale nous comprenons l'heure adoptée officiellement dans un
point donné ( l'heure selon laquelle fonctionnent les institutions et vit
la population ).
Elle correspond soit à l'heure zonale, soit en est distincte d'un nombre entier
d'heures.
Dans la plupart des cas, les observateurs indiquent l'heure locale légale.
Pour passer de celle-ci à l'heure solaire moyenne, nous avons utilisé la "liste
des territoires sur lesquels le comptage du temps réel est différent de celui
établi".
La prise en compte de la redondance s'est faite pour les rapports indiqués
dans le tableau n°7.
Ici, pour toutes les observations "coïncidentes" l'heure est prise en compte une
seule fois.
Comme on le voit en figure 10, la prise en compte de la redondance ne change pas
le caractère de la répartition.
Le maximum des observations a lieu dans les heures de la soirée : vers
21 heures.
En outre, on remarque un maximum secondaire faiblement marqué le matin, vers les
7 heures.
En figure 11, on présente la comparaison des données soviétiques et étrangères,
celles-ci ont été prélevées dans l'étude (Ref. 1).
Les courbes sont normalisées selon le nombre de cas les surfaces bornées par toutes
les courbes sont identiques.
Comme on peut le voir, le caractère de la répartition pour les différents pays est
de façon générale, identique.
Le maximum nettement marqué des heures du soir reste inchangé.
Pour les observations soviétiques, celui-ci est plus pointu. La prise en compte
de la redondance permet d'abaisser un peu le maximum, mais il reste cependant plus
élevé que celui obtenu d'après les données de l'étranger.
Apparemment, c'est une propriété réelle de l'échantillon étudié.
Selon VALLÉE et POHER (Ref. 1), la courbe observée est une conséquence de la superposition de deux effets :
- la répartition vraie du phénomène,
- l'occupation journalière de la population ( le temps pendant lequel la population active ne se trouve pas chez elle ).
Après réduction à cet effet, le maximum de répartition se déplace sur les heures après minuit ( environ 3 heures après minuit ), et la quantité totale des cas enregistrés doit être augmentée de 14 fois (Ref. 1).
En figure 12, on a présenté la répartition dans la journée pour les différentes
saisons de l'année.
En hiver, le maximum se produit moins tard, ceci est apparemment lié à l'obscurité
qui tombe plus tôt.
Il est souhaitable d'étudier plus en détail le rapport de l'heure de la tombée de
la nuit.
Notons qu'en hiver, une part importante des observations a lieu dans la période de
la journée où la population active ne se trouve pas chez elle.
Donc, l'hypothèse interprétative utilisée par VALLÉE et POHER (Ref. 1)
n'est pas tout à fait sans ambiguïté.
Il semble qu'en plus de l'occupation de la population, il faut également tenir
compte de la durée des heures claires et des heures sombres de la journée.
En figure n° 13, on a présenté la répartition du nombre de cas d'observations
en fonction du temps sidéral au point d'observation.
Pour la répartition obtenue selon tout l'échantillon ( figure 13a )
outre le maximum principal ayant lieu à 18-19 heures, on voit nettement apparaître
un maximum secondaire, avec un décalage par rapport au premier de 6 heures et
ayant lieu à 12-13 heures du temps sidéral.
Il semble que ces particularités de répartition sont surtout propres à l'année
1967 qui présente le plus grand apport de l'échantillon considéré.
Pour les autres années ( sauf 1967 ) la répartition est plus homogène
( figure 13b ).
Il faut cependant tenir compte que la statistique pour ces années-ci est
pauvre.
En figure n° 14, on présente la répartition du nombre de cas en fonction de l'heure universelle.
Retour au SOMMAIRE
6. CLASSIFICATION DES PHÉNOMÈNES, DU TYPE DES OBJETS
Pour les caractéristiques des types des objets, nous avons utilisé les critères
suivants : netteté, transparence et forme.
Dans le premier critère, tous les objets peuvent être rangés dans trois
aspects :
- objets semblables à des nuages, avec un bord non net, flou,
- objets à contours nets ( "corps" ),
- objets d'aspect intermédiaire. ( Cet aspect est utilisé lorsqu'il est difficile de ranger l'objet observé dans l'un des deux aspects précédents, par exemple : lorsqu'une partie du contour est nette et une partie est floue ).
En ce qui concerne la transparence, il y a également 3 aspects d'objets :
- non transparents,
- transparents,
- semi-transparents.
Les formes observées des objets anormaux sont très diversifiées.
Ceci peut s'expliquer soit par la diversité du phénomène lui même, soit, parce que
nous avons ici affaire à des phénomènes de nature différente.
Peut-être que les deux facteurs agissent.
De plus, il faut tenir compte qu'un même objet observé sous des angles différents
peut apparaître et être classé différemment.
Enfin il faut tenir compte des facteurs psychologiques : en observant un
phénomène inhabituel auquel il ne s'attend pas et souvent complexe, le témoin le
perçoit différemment, et dans la rédaction écrite, les rapports comportent des
déformations supplémentaires car il est souvent très difficile de transmettre
précisément ses impressions.
La classification des formes des objets est présentée dans le tableau 8.
Il va de soi que celle-ci est purement conventionnelle, les critères de formes
adoptés ont été pris d'après les descriptions des témoins ( telles qu'ils
les citent dans leurs rapports ).
De plus, les différences entre certains types de formes sont uniquement
conventionnelles.
Par exemple, on ne peut pas toujours distinguer un disque plat rond d'un objet de
forme sphérique situé à une grande distance ; ou bien un disque vu de côté
d'un objet ovale.
Tout aussi conventionnelle est la différence entre un corps ovale et une sphère
légèrement déformée ( aplatie ) ainsi que celle entre un ovale allongé
et un "concombre" ou un "cigare".
Il semble que l'on puisse distinguer les formes principales d'objet suivantes :
- Objets en forme d'étoile, objets de faibles dimensions angulaires
( au-delà des limites de résolution de l'il humain ).
En ce sens, une "étoile de volume visible" signifie manifestement un objet dont les dimensions angulaires se situent à la limite de la résolution.
Parfois, des objets en forme d'étoile ont pu être vus au télescope ou à la lunette, dans ce cas ils peuvent avoir une forme tout à fait différente. - Corps sphériques ( y compris sphères aplaties ou ovales pas très
allongées ).
Comme ils sont perçus par rapport à leur volume, on peut penser que ce sont des objets relativement proches. - Objets en forme de disque.
- Objets oblongs ( ovales très étirés, "concombres", "cigares", "cylindres", "barres" ).
- Objets en forme de croissant. Par leur forme, dimensions angulaires et
brillance, ils rappellent la lune dans ses phases précédant le 1er quart.
D'habitude, ils se déplacent assez rapidement dans le ciel.
Dans une série de cas, ils ont été observés en même temps que la vraie lune.
On distingue les croissants droits ( "à deux cornes" ) et ceux "à une corne", une forme rappelant une virgule à l'envers.
Souvent, ils sont accompagnés d'un ou de plusieurs objets en forme d'étoile.
De façon générale, c'est un type assez rare d'objets.
Pourtant, en été 1967, ils ont été observés assez souvent au-dessus de la partie sud du territoire européen d'URSS.
C'est pourquoi, dans l'échantillon considéré, ces objets représentent une part importante ( cf. tableau n°8 ). - Objets de forme régulière "exotique" ( triangle, carré, anneau, etc...).
- Objets de forme irrégulière.
- Objets de forme changeante, constamment.
Il faut remarquer que dans cette classification, on ne prend en considération
que la forme principale de l'objet.
On ne tient absolument pas compte de détails secondaires comme par exemple la
présence d'une queue lumineuse ou bien d'autres particularités de structure :
ces caractéristiques seront examinées à part ( dans le chapitre 8 ).
Retour au SOMMAIRE
6.1. ÉTAPES DE CONSTITUTION DE FORMES ET TRANSITIONS ENTRE ELLES
Dans l'analyse de la forme, il faut distinguer les trois types suivants de phénomènes :
On observe un ou plusieurs objets de forme constante.
On observe un ou plusieurs objets de forme changeant constamment.
On observe un ou plusieurs objets de forme stable, puis a lieu une modification de formes, par suite de laquelle on observe un autre objet ou groupe d'objets également de forme stable.
Ces modifications comprennent :modification de la forme de l'objet ( transition d'une forme à une autre ),
séparation de deux objets entre eux,
jonction d'un objet à un autre,
"extinction" d'un objet lumineux,
dissipation progressive d'un objet,
apparition d'un nouvel objet,
etc...
Dans tous les cas où il y a une telle modification, nous parlons de plusieurs étapes de constitution de formes.
A chaque phase, les objets ont une forme stable.
On peut distinguer les phases du phénomène également à partir d'autres indications, par exemple d'après la modification des caractéristiques du mouvement.
Pour souligner qu'il s'agit d'une modification de la forme, nous nommons les étapes correspondantes "phases de constitution de forme".
Dans la plupart des cas ( 77,5% ), les témoins ont observé une seule
phase de formation de la forme ; Dans 29 cas, ( 11% ), deux phases ont
été observées ; Dans 20 cas, ( 8% ), trois phases ; Dans 9
cas, ( 3,5% ) ; plus de trois phases.
Au total, on a remarqué des modifications de phases de constitution de forme dans
58 cas sur 256 ( 22,5% ).
149 modifications particulières y ont été observées concernant les objets :
| - transition d'une forme à une autre..... | 51 cas... | soit 39 % |
| - extinction d'un objet..... | 33 cas... | soit 22 % |
| - dissipation d'un objet..... | 17 cas... | soit 11 % |
| - apparition d'un nouvel objet..... | 29 cas... | soit 20 % |
| - séparation de deux objets l'un de l'autre..... | 17 cas... | soit 11 % |
| - adjonction d'un objet à un autre..... | 1 cas... | soit près de 1 % |
| - division d'un des objets .., | 1 cas | soit près de 1 % |
Retour au SOMMAIRE
6.2. STATISTIQUE DES TYPES D'OBJETS
La présence de plusieurs phases de constitution de formes donne une certaine
imprécision dans la statistique car il se pose le problème de savoir combien de
fois on doit prendre en compte un objet d'un même type observé dans diverses
phases.
Nous avons compté de tels objets une seule fois (*).
(*) Par contre, mais ce n'est pas dit explicitement, diverses
phases occasionnant des formes de types différents, sont sans doute comptées
séparément.
C'est ce qui permet d'atteindre le total de 457 (N.D.G.).
La prise en compte de la redondance ( cf. § 5.2 ) s'est faite de la façon suivante :
pour les observations "coïncidentes" ( tableau n°7 ), les objets, dont toutes les caractéristiques du type adopté, sont identiques, n'ont été pris en compte qu'une fois ;
les objets dont une seule caractéristique ne correspond pas, ont été considérés différents et sont comptés chacun à part.
Par exemple, si en un même moment, on a observé en différents points un objet en
forme de croissant, il est pris en compte une seule fois.
Si au même moment à d'autres points, on a observé un objet sphérique, il est
considéré à part.
Les questions concernant le changement de la perspective lors de l'observation
des différents points, ne sont pas prises en compte ici.
Ceci nécessite une analyse détaillée complémentaire concernant chaque point concret.
Tenant compte de ces remarques, la statistique a l'aspect suivant : dans 256 cas, on a enregistré les objets ainsi répartis :
| TYPES D'OBJETS | SANS REDONDANCE | AVEC REDONDANCE | ||
| cas | % | cas | % | |
| SELON LE CARACTÈRE DE NETTETÉ : | ||||
| . aspect nuageux | 68 | 15 | 68 | 16,5 |
| . objet à contour net ("corps") | 358 | 78 | 318 | 76 |
| . objet de type intermédiaire | 7 | 2 | 7 | 2 |
| . type difficile à déterminer | 24 | 5 | 23 | 5,5 |
| SELON LE CARACTÈRE DE LA TRANSPARENCE : | ||||
| . non transparent | 431 | 94 | 391 | 94 |
| . transparent ou semi-transparent | 11 | 2,5 | 11 | 2,5 |
| . type difficile à déterminer | 15 | 3,5 | 14 | 3,5 |
| TOTAL | 457 | 416 | ||
| Forme des objets | Nombre d'objets | |||
| Sans redondance | Avec redondance | |||
| OBJETS EN FORME D'ETOILE dont : |
97 | 21 % | 78 | 19 % |
| - étoile | 85 | 66 | ||
| - "étoile" de volume visible | 12 | 12 | ||
| CORPS SPHERIQUES dont : |
47 | 10 % | 44 | 11 % |
| - sphère régulière | 28 | 28 | ||
| - sphère déformée | 6 | 6 | ||
| CORPS RONDS, DISQUES dont : |
66 | 14,5 % | 65 | 15,5 % |
| - disque visible de l'arête | 7 | 7 | ||
| - disque rond (frontal) | 46 | 45 | ||
| OBJETS EN FORME DE CROISSANT dont : |
109 | 24,5 % | 93 | 22,5 % |
| - croissant de forme symétrique | 72 | 61 | ||
| - croissant non symétrique ("virgule") | 18 | 16 | ||
| OBJETS OBLONGS dont : |
31 | 7 % | 31 | 7,5 % |
| - corps ovale | 19 | 19 | ||
| - ovale très étiré ("cigare", "concombre") | 4 | 4 | ||
| OBJETS DE FORME REGULIERE "EXOTIQUE" dont : |
32 | 7 % | 30 | 7,5 % |
| - triangle | 4 | 3 | ||
| - rectangle | 4 | 4 | ||
| - raie | 7 | 7 | ||
| - anneau | 6 | 6 | ||
| - coupole | 3 | 3 | ||
| - demi-sphère | 2 | 1 | ||
| OBJETS DE FORME IRREGULIERE dont : |
30 | 6,5 % | 30 | 7 % |
| - tâche irrégulière | 7 | 7 | ||
| - en forme de comète | 6 | 6 | ||
| - polygone irrégulier | 1 | 1 | ||
| OBJET DE FORME CHANGEANT CONSTAMMENT | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| FORME DIFFICILE A DETERMINER | 12 | 2,5 % | 12 | 3 % |
| FORME NON INDIQUEE | 31 | 6,5 % | 31 | 7,5 % |
| TOTAL | 457 | 100 % | 416 | 100 % |
- TABLEAU N° 8 -
- Répartition des objets selon leur forme -
NOTA : Le détail des modalités ne couvre pas toujours tous les aspects de la modalité et la somme des formes détaillées d'une modalité est donc parfois inférieure au nombre de cas de la modalité (NDG).
Retour au SOMMAIRE
6.3. OBSERVATION SIMULTANÉE DE PLUSIEURS OBJETS
Dans la plupart des cas, on a observé un seul objet.
Cependant, dans environ le tiers des cas, on a observé simultanément plusieurs
objets.
C'est dire :
| sans la redondance | avec la redondance | |
| - deux objets | 62 cas | 45 cas |
| - trois objets | 24 cas | 22 cas |
| - quatre objets | 6 cas | 6 cas |
| - plus de 4 objets | 2 cas | 2 cas |
| TOTAL | 94 cas | 75 cas |
Dans une série de cas, il y a eu observation de plusieurs objets pas simultanément mais de façon successive ( dans différentes phases du phénomène ).
Parmi les cas où il a été observé plus d'un objet, dans la moitié des cas
( 47 sur 94 ), on a remarqué une association d'objets de forme variable
avec des formes d'étoile.
Très souvent, il s'associe à ceux-ci des objets en forme de croissant :
42 cas sur 47, ce qui fait 89% de tous les cas où il y a association avec des
objets en forme d'étoile.
Par rapport à l'ensemble des cas d'observation d'objets
en forme de croissant, on a :
| sans la redondance | avec la redondance | |
| - nombre total d'objets | 109 cas | 93 cas |
| - nombre d'objets liés à des formes d'étoiles | 42 cas (38 %) |
31 cas (33 %) |
Ainsi, dans environ un tiers des cas, les objets en forme de croissant sont associés à ceux en forme d'étoile.
Retour au SOMMAIRE
7. DURÉE DES ÉVÈNEMENTS
7.1. DUREE GÉNÉRALE DES ÉVÉNEMENTS, RÉPARTITION SELON LA DUREE
Nous appellerons durée de l'évènement, l'intervalle de temps entre le début et la fin de l'observation.
Dans la plupart des cas, la durée de l'évènement est inférieure à celle du phénomène.
Dans 146 cas sur 256 ( 57% ), on indique comment a commencé
l'observation.
Dans 42 cas, le début de l'observation coïncide avec le début du phénomène
( ou de l'apparition de l'objet ).
Dans 104 cas, le début du phénomène précède celui de l'observation.
Dans 141 cas ( 55% ), on indique la fin de l'observation.
Dans 47 cas, elle s'est arrêtée au moment de la fin du phénomène.
Dans 14 cas, l'observation a pris fin avant la fin du phénomène ( les gens
ont pris une autre occupation et ont cessé d'observer ).
Dans 57 cas, l'objet s'est éloigné au point qu'il a cessé d'être visible.
Dans 23 cas, l'objet a été caché par un obstacle ( ou a quitté l'horizon ).
La durée d'observation des phénomènes anormaux est indiquée dans 177 cas.
Parmi ceux-ci, dans 13 cas, la durée de l'évènement est indiquée de façon
approximative ( "quelques secondes", "quelques minutes", "quelques dizaines
de minutes" ).
Dans 164 cas, on donne une valeur chiffrée de la durée pour certains d'entre-eux
elle n'est communiquée que pour l'une des phases du phénomène.
Dans 144 cas, la durée concerne tout le phénomène.
Nous l'appelons : durée totale de l'évènement.
Dans 14 de ces cas, l'heure du début et de la fin de l'observation correspond au
début et à la fin du phénomène.
Dans ces cas là, la durée totale de l'événement correspond à celle du phénomène
lui-même.
Dans les autres cas, on peut la considérer comme limite inférieure de la durée du
phénomène.
La répartition du nombre de cas d'observation selon la durée ( pour la
durée totale des évènements ), est présentée en figure 15.
Le maximum de la répartition est obtenu pour l'intervalle 1/4 minutes.
La comparaison avec les données de l'étranger ( d'après l'étude -
Ref. 1 ) est présentée en figure 16.
On peut voir une similitude incontestable pour les différents pays, ce qui
témoigne du caractère commun du phénomène observé.
Retour au SOMMAIRE
7.2. RÉPARTITION SELON LA DURÉE POUR DES OBJETS DE TYPES DIFFÉRENTS
La répartition selon la durée des évènements pour des objets de types
différents, est présentée en figure 17.
Le caractère de la répartition pour des objets différents est différent.
Les objets de forme sphérique et les disques se distinguent par une répartition
plus homogène.
Les objets en forme de croissant, outre le maximum principal ( obtenu pour
1/4 min. ), se caractérisent par un maximum secondaire d'une durée de
l'ordre de quelques secondes.
Les objets de forme irrégulière s'observent pendant de plus longues durées,
parmi ceux-ci un remarque nettement une part d'évènements d'une durée de l'ordre
d'une heure.
A ce point de vue, la répartition des objets de forme "exotique" régulière
(
triangle, carré, etc...) est tout à fait caractéristique.
Bien sûr, les caractéristiques indiquées ne peuvent pas être considérées comme
solidement établies : la statistique pour certains types d'objets
est trop pauvre.
Cependant, on peut penser que la prédominance d'évènements de plus longue
durée, venant de l'observation d'objets de forme irrégulière, et surtout de
forme "exotique" régulière, est tout à fait réaliste.
Retour au SOMMAIRE
8. STRUCTURE DES OBJETS ET CARACTÈRE DE LEUR LUMINESCENCE
Outre leur forme, les objets anormaux sont souvent caractérisés par différents détails internes ou externes ( de la surface, de la structure ), mais également souvent par le caractère tout à fait complexe de leur luminescence.
Ci-dessous, sont présentées les caractéristiques des objets.
Retour au SOMMAIRE
8.1. DÉTAILS EXTÉRIEURS
Au total, dans 256 cas étudiés d'observations d'objets anormaux, 457 objets
différents sont décrits ( redondance non prise en compte ).
Pour 254 objets il n'y a dans les rapports aucune information sur les détails
extérieurs.
On peut penser que dans ces cas, soit ils sont absents, soit ils sont exprimés
de façon évidente.
La présence ou l'absence de détails extérieurs est notifiée dans 129 cas
( pour 193 objets ).
De plus, dans 17 cas ( pour 25 objets ), les témoins remarquent
l'absence de tout détail extérieur.
Pour les 168 autres objets dans les rapports, sont décrits certains détails
extérieurs.
Ces données sont présentées dans le tableau n°9.
Pour neuf objets sur les 168, on remarque 2 détails.
Les objets correspondants sont pris en compte deux fois dans le tableau.
C'est pourquoi le nombre total des objets dans la deuxième colonne du tableau
n°9 est égal à 177.
Le pourcentage est pris à partir du nombre total d'objets : 168.
| DESCRIPTION DES DÉTAILS | NOMBRE D'OBJETS | % DU NOMBRE TOTAL D'OBJETS A DÉTAILS EXTÉRIEURS |
| QUEUE dont : - queue sombre, traînée sombre...9 - queue brillante, forme variable...55 |
71 | 42 |
| ÉTINCELLES | 37 | 22 |
| FLUX ORIENTES DE LUMIERE (rayons, arcs lumineux, colonne lumineuse, cône de lumière, etc.) | 30 | 18 |
| FLAMME | 14 | 8 |
| LUMINESCENCE AUTOUR DE L'OBJET (auréole éclat, etc.) | 13 | 8 |
| ENVELOPPES DE FORMES VARIABLES | 12 | 7 |
| TOTAL | 177 | 105 |
- TABLEAU n° 9 -
- DÉTAILS EXTÉRIEURS -
Retour au SOMMAIRE
8.2. DÉTAILS INTÉRIEURS, STRUCTURE DE SURFACE DES OBJETS
Dans les rapports pour 71 cas d'observation ( 28% des 256 cas ),
il y a une indication sur la présence ou l'absence de la structure de surface des
objets.
De plus, dans 12 cas ( pour 20 objets ) on remarque que la surface des
objets est homogène.
La présence d'une structure visible ou d'une inhomogénéité de la surface est notée
dans 82 cas ( 18% des 457 objets ).
Pour 355 objets, il n'y a pas d'indications sur la structure.
Peut-être que dans ces cas, il n'y avait pas de détails "intérieurs"
( structure homogène ) ou bien qu'ils étaient faiblement contrastés
et peu discernables à l'il nu.
De plus, il faut considérer que l'attention des observateurs ne se porte pas
toujours sur ces détails.
Les données sur la structure de surface et sur les détails "intérieurs" des
objets sont portées dans le tableau n°10.
Pour 3 objets, on note deux caractéristiques d'inhomogénéité, ces objets sont
pris en compte deux fois dans le tableau.
| Caractère de l'inhomogénéité | Nombre d'objets | % des 82 objets de surface inhomogène |
| INHOMOGENEITE STATIONNAIRE dont : |
62 | 75 |
| --- raie sombre | 3 | |
| --- raie claire | 1 | |
| --- feux, tâche lumineuse | 4 | |
| --- hachures | 5 | |
| --- bord brillant | 15 | |
| --- autres inhomogénéités | 34 | |
| INHOMOGENEITE NON STATIONNAIRE dont : |
19 | 23 |
| --- écoulement, courant | 3 | |
| --- tourbillons | 1 | |
| --- structure de flamme | 9 | |
| --- flambeaux | 1 | |
| --- étincelles | 5 | |
| PRESENCE DE DETAILS PROTUBERANTS
rappelant des détails de "structure" |
4 | 5 |
| TOTAL | 85 | 103 |
- TABLEAU N° 10 -
Détails "intérieurs", structures de surface des objets
Retour au SOMMAIRE
8.3. CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMINESCENCE
On possède des indications sur le caractère de la brillance dans 240 cas
d'observations ( 94% des 256 cas ).
Dans 16 cas ( ou 36 objets ) il n'y a aucune indication sur la brillance
ou bien ses caractéristiques ne sont pas claires.
La brillance de 421 objets est caractérisée d'une manière ou d'une autre par les
observateurs.
Les données sur le caractère qualitatif de la brillance sont présentées dans le
tableau n°11.
| Caractère de la brillance | Nombre d'objets | % du nombre total des 421 objets avec indications sur la brillance |
| Corps visible sur un fond de ciel clair dans la lumière réfléchie | 21 | 5 |
| Corps sombre | 32 | 8 |
| Corps brillant sur le fond de ciel sombre | 368 | 87 |
| TOTAL | 421 | 100 |
- TABLEAU n° 11 -
Caractère de la brillance
Retour au SOMMAIRE
La nature de la brillance sur fond de ciel sombre est difficile à établir,
pour cela il faut une analyse spéciale.
On peut penser que dans la plupart des cas, nous avons affaire à la brillance
des objets eux-mêmes.
Pour 4 objets, selon l'avis des observateurs, la brillance est liée à la
réflexion de la lumière du soleil.
L'intensité de la brillance est estimée par les observateurs ( surtout
qualitativement ) pour 183 objets.
Ces données sont portées dans le tableau n°12.
Pour 249 objets, les observateurs présentent des données sur le caractère de
variation de l'intensité.
Parmi ceux-ci, pour 157 objets, l'intensité de la clarté est restée constante
pendant toute l'observation, pour 56 objets on a observé une diminution de
l'intensité, pour 8 objets une augmentation, pour 18 objets on a remarqué des
variations brutales de l'intensité du type de l'éclair ou de l'explosion.
| Caractéristiques qualitatives de l'éclat | Nombre d'objets | % du nombre total de 183 objets où l'intensité de l'éclat est indiquée |
| Aveuglant | 9 | 5 |
| Intense | 101 | 56 |
| Moyen | 19 | 10 |
| Faible | 15 | 8 |
| Comme celui de la Lune | 21 | 12 |
| Comme celui du Soleil | 2 | 1 |
| Comme celui de la voie lactée | 2 | 1 |
| Comme celui d'un satellite | 4 | 2 |
| La valeur de l'intensité est présentée en magnitude stellaire | 10 | 5 |
| TOTAL | 183 | 100 |
- TABLEAU N° 12 -
Intensité d'éclat
Retour au SOMMAIRE
8.3.1. Couleur des objets
Pour 184 cas d'observations ( pour 295 objets ), on possède des
données sur la couleur.
Pour 162 objets, ces données soit marquantes.
La gamme des couleurs, conformément aux indications des témoins, est extrêmement
large.
Ces données sont présentées dans le tableau n°13.
Remarquons que pour 53 objet, il a été remarqué une couleur complexe mélangée
( par exemple : jaune/vert ).
12 objets avaient une surface de couleurs variées.
Dans tous les cas, on a tenu compte de claque couleur à part.
Les objets correspondants sont pris en compte dans le tableau n°13, plus d'une fois.
8.3.2. Variation de la couleur
Dans 23 cas, on a observé une dynamique de la couleur de brillance
( modifications aussi bien dans le sens d'une diminution de la longueur
d'onde que d'une augmentation de celle-ci : pulsations, chatoiements,
variation de la couleur d'un secteur de la surface vers un autre ).
Au total, on a observé des variations de la couleur dans 28 objets.
Dans 61 cas sur 162 objets, on a noté l'absence de variation de la couleur de
brillance.
Dans les autres cas, il n'y a aucune indication sur la dynamique
de la couleur de brillance.
| Couleurs | Nombre d'objets | % du nombre total l (295) avec couleur indiquée |
| rouge, rose | 74 | 25 |
| orange, "feu" | 74 | 25 |
| jaune, "dorée" | 57 | 19 |
| vert | 12 | 4 |
| bleu ciel | 33 | 11 |
| bleu foncé | 2 | 1 |
| violet | 4 | 1,5 |
| noir | 8 | 2,5 |
| gris | 3 | 1 |
| blanc | 73 | 25 |
| perle | 4 | 1,5 |
| argent | 9 | 3 |
| avec une nuance métallique | 7 | 2 |
- TABLEAU n° 13 -
Couleur des objets
Retour au SOMMAIRE
9. DIMENSIONS ANGULAIRES DES OBJETS
9.1. ESTIMATION DES DIMENSIONS ANGULAIRES PAR LES TÉMOINS
L'estimation des dimensions angulaires pour des observateurs, non préparés
offre apparemment de grande difficultés.
Dans les rapports on trouve souvent des descriptions du type :
"l'objet avait la dimension d'une orange", "d'une pomme", "d'une pastèque ",
d'une " balle de tennis", etc... sans indication sur la distance d'où a été
observé l'objet : comparé.
Il n'est pas possible d'utiliser rationnellement de telles estimations.
Pour 244 objets ( sur 457 ) il y a dans les rapports une tentative
de donner une estimation qualitative ou quantitative des dimensions angulaires.
Parmi ceux-ci : 94 objets sont estimés comme des étoiles
( mesure angulaire=0 ) ; 7 objets sont caractérisés par de
"faibles" mesures angulaires ; 31 objets par de grandes "mesures" angulaires.
Pour les autres 112 objets, on donne une estimation quantitatives.
Il faut avoir en vue qu'il s'agit d'estimations visuelles faites par des
observateurs peu préparés.
Si, souvent pour l'estimation des mesures angulaires, on utilise comme
comparaison la Lune ou le Soleil, ces comparaisons se font dans la plupart des
cas de mémoire ( en absence de la Lune ou du Soleil à observer en même temps
que l'objet décrit ).
C'est pourquoi les estimations présentées ne donnent qu'une estimation tout à fait
grossière des mesures angulaires réelles des objets.
Les résultats des estimations sont présentés dans le tableau n°14.
Pour 18 objets sur 206 (112 + 94) on présente dans les rapports deux
valeurs différentes de mesures angulaires ( dans les cas d'une variation de
la mesure angulaire ou de l'observation d'un objet asymétrique ).
Les objets correspondants sont pris en compte deux fois dans le tableau.
| Mesure angulaire (approximatif) | Nombre d'objets |
| 0 (objet comme une étoile) | 94 |
| 15' et moins | 41 |
| 30' | 61 |
| 45' | 2 |
| 1° | 11 |
| 2° et plus | 5 |
| TOTAL | 214 |
- TABLEAU n° 14 -
Mesures angulaires des objets
Retour au SOMMAIRE
9.2. MODIFICATION DES MESURES ANGULAIRES
Pour la plupart des objets, on ne dit rien sur les modifications des mesures
angulaires dans les rapports.
Pour 150 objets, on note que les mesures angulaires sont restées constantes.
Une augmentation des mesures angulaires est notée pour 36 objets, une diminution
pour 22 objets.
9 objets présentaient au début des mesures angulaires constantes, puis se sont
mise à se modifier.
La modification des mesures angulaires visibles des objets est due à une
modification de la distance à l'objet lors de son mouvement, ou bien par suite de
la modification des dimensions linéaires ( par exemple : élargissement
d'un objet ressemblant à un nuage ).
Dans l'analyse des rapports que l'on possède, il est difficile de faire la
délimitation entre ces deux cas d'autant plus qu'il est possible que ces deux cas
se superposent.
Dans les données présentées, aucune délimitation n'a été faite.
Retour au SOMMAIRE
10. CARACTÉRISTIQUE DU MOUVEMENT DES OBJETS
Les données présentées dans les rapports sur le mouvement des objets comprenaient des caractéristiques qualitatives de la vitesse et de sa variation, ainsi que des données sur le caractère de la trajectoire et sur la direction de vol.
10.1. VITESSE ET ACCELERATION
Des données sur le caractère qualitatif de la vitesse sont indiquées dans 80
cas d'observation pour 176 objets.
Dans 69 cas, pour 3 objets, elle présente une caractéristique de régularité.
Dans 36 cas pour 65 objets, les témoins remarquent une irrégularité de mouvement,
comprenant :
| - vitesse modifiée 1 fois..... | 29 cas... | pour 53 objets |
| - vitesse modifiée 2 fois..... | 2 cas... | pour 2 objets |
| - vitesse modifiée 3 fois..... | 2 cas... | pour 2 objets |
| - vitesse modifiée plusieurs fois..... | 1 cas... | pour 4 objets |
| - mouvement par à-coups..... | 2 cas... | pour 4 objets |
De plus, il a été remarqué un mouvement avec accélération dans 21 cas ( pour 36 objets ), un mouvement avec ralentissement dans 9 cas ( pour 18 objets ) et une modification du signe de la vitesse ( changement d'accélérations et de ralentissements ) dans 6 cas pour 11 objets.
Dans 18 cas ( pour 21 objets ) il a été remarqué une modification brutale de la vitesse ( accélération élevée ), dans 15 cas ( 41 objets ) une modification régulière de la vitesse, dans 3 cas ( 3 objets ) la caractéristique d'accélération n'est pas donnée.
Ci-dessous, sont données les indications sur les vitesses angulaires des objets.
Dans 152 cas d'observation pour 242 objets, il y a tentative de caractériser la
valeur de la vitesse angulaire.
Dans la majorité des cas, on donne des caractéristiques qualitatives de la vitesse
"élevée" (47 cas), "faible" (33 cas) "moyenne" (2 cas), "semblable à un avion"
(41 cas), "semblable à un satellite" (15 cas).
Dans 14 cas, on évalue la vitesse proche de zéro.
Pour 14 cas, on donne des valeurs chiffrées de la vitesse angulaire.
Ces données sont présentées dans le tableau n° 15.
Retour au SOMMAIRE
10.2. TRAJECTOIRE DES OBJETS
Pour 51 objets sur 457, le caractère du mouvement des objets n'est pas indiqué
ou n'est pas clair.
Pour 406 objets, on donne dans les rapports des indications sur le mouvement.
Parmi ceux-ci, on note 8 objets tournants.
Les données sur les trajectoires des 406 objets sont présentées dans le tableau n°16.
Parmi celles-ci, pour 24 objets, on a observé deux trajectoires différentes, pour
11 objets : 3 trajectoires, pour 2 objets : 4 trajectoires et pour 1
objet : 6 trajectoires.
Ces objets sont respectivement pris en compte 2, 3, 4 et 6 fois dans le tableau n°16.
Il faut en tenir compte lors de la détermination du nombre total d'objets de la
deuxième colonne.
| VITESSE ANGULAIRE | NOMBRE DE CAS |
| 1 degré/min. | 2 |
| 2 degrés/min. | 1 |
| 3 degrés/min. | 1 |
| 40 degrés/min. | 1 |
| 1 degré/sec. | 2 |
| 1,5 degré/sec. | 2 |
| 2 degrés/sec. | 1 |
| 4 degrés/sec. | 1 |
| 5 degrés/sec. | 1 |
| 9 degrés/sec. | 1 |
| 20 degrés/sec. | 1 |
-TABLEAU n° 15-
Vitesse angulaire des objets
Retour au SOMMAIRE
| Type de trajectoire Caractère du mouvement |
Nombre d'objets | % des 406 objets comprenant des indications de trajectoires |
| - Trajectoire régulière, le caractère du mouvement ne change pas | 294 | 70 |
| - Modification de la direction du vol 1 ou plusieurs fois | 45 | 11 |
| - Manuvres des objets (réciproques ou par rapport à des avions) | 17 | 4 |
| - L'objet est immobile (suspendu) | 45 | 11 |
| - On remarque une "mise en suspension" ou un arrêt (sortie) de celle-ci | 61 | 15 |
| - Trajectoires inhabituelles (balancement, spirale, sinusoïde, contour d'obstacles, vol en cercle) | 11 | 3 |
| TOTAL | 463 | 114 |
- TABLEAU N° 16 -
Trajectoires du mouvement des objets
Retour au SOMMAIRE
Ensuite, comme on petit le voir dans le tableau n° 16, dans la plupart des cas
(284 sur 406) , il a été observé un mouvement selon une trajectoire régulière.
Cependant, pour 122 objets ( 30 % du nombre total d'objets comprenant des
indications sur la trajectoire ), des particularités fondamentales
ont été remarquées :
modification brutale de la course, mise en suspension, manuvres des objets,
rotation, trajectoires inhabituelles.
Retour au SOMMAIRE
10.3. DIRECTION DU VOL
Dans les observations à l'il nu, il n'est possible de déterminer la direction
réelle du mouvement d'un objet éloigné que lorsqu'il passe le zénith.
Dans les autres cas, nous obtenons la direction visible du mouvement dans la
projection sur la sphère céleste.
Sans information complémentaire, la réduction à la direction vraie est assez
imprécise, cependant les erreurs ne dépassent pas 90°.
C'est pourquoi ces données ne peuvent être utilisées que pour faire une
détermination statistique grossière des directions prédominantes du mouvement.
En ce qui concerne les erreurs dans l'estimation de la direction par l'observateur
lui-même, elles ont un caractère aléatoire et donc, ont peu d'influence sur
les directions prédominantes déduites d'un grand ensemble de données.
Pour simplifier la représentation, nous n'avons considéré que les objets
s'éloignant et n'avons tenu compte que de la vitesse d'éloignement, et non de la
direction d'où est apparu l'objet.
Pour les objets dont la direction du mouvement a varié pendant l'observation,
nous n'avons considéré que la direction de l'éloignement final de l'objet.
Cette procédure permet d'obtenir une répartition grossière des objets selon les
directions du mouvement.
Dans 99 cas sur 256, la direction de l'éloignement n'est pas indiquée.
Dans 157 cas, on donne la direction de l'éloignement pour 220 objets.
La répartition selon les directions est déterminée par deux procédés différents.
Dans le premier sont choisis tous les cas où tous les objets observés simultanément
se sont éloignés dans une même direction, et on établit la répartition du nombre de
cas en fonction de la direction de l'éloignement.
Dans le second, on a tenu compte de tous les objets s'éloignant ( aussi bien
ceux se dirigeant vers une même direction due ceux se dirigeant vers des directions
différenties ), et on en a déduit la répartition du nombre d'OBJETS en
fonction de la direction.
Les résultats sont présentés dans le tableau n°17 et la figure n°18.
Comme on peut le voir, la répartition moyenne pour toutes les années, à
l'exception de 1967, est assez symétrique.
Certains écarts sont statistiquement sans signification et ont sans doute un
caractère aléatoire.
Cependant, la répartition pour l'année 1967 est manifestement asymétrique :
les mouvements dans la direction de l'Est prédominent.
Ceci se voit de façon évidente sur la figure n°18.
La répartition selon le nombre de cas et selon le nombre d'objets est, de façon
générale, semblable.
| Direction d'éloignement des objets | Nombre de cas | Nombre d'objets | ||||
| Total | 1967 | Sauf 1967 | Total | 1967 | Sauf 1967 | |
| Sud | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| Sud-est | 14 | 12 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| Est | 64 | 59 | 5 | 95 | 84 | 11 |
| Nord-est | 33 | 29 | 4 | 55 | 50 | 5 |
| Nord | 15 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 |
| Nord-ouest | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Ouest | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Sud-ouest | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 |
| TOTAL | 149 | 118 | 31 | 220 | 176 | 44 |
- TABLEAU N° 17 -
Répartition selon les directions
Retour au SOMMAIRE
Les répartitions pour des types particuliers d'objets sont présentées en figure
n°19.
Elles sont classées d'après le nombre d'objets ( le nombre total d'objets d'un
type donné, totalisé pour toutes les directions est pris égal à l'unité ).
On ne comprend pas dans la catégorie "objets d'autres types" les objets en forme
d'étoile, associés à des formes de croissant, ou des sphères ou des disques.
Comme on peut le voir, l'asymétrie est déterminée essentiellement par les objets
en forme de croissant mais également par des sphères et des disques.
Cependant, les objets en forme de croissant ont une contribution essentielle dans
la statistique générale car leur nombre est plus important.
Retour au SOMMAIRE
11. ESTIMATIONS DE VALEURS LINÉAIRES
( DISTANCE, ALTITUDE, DIMENSION, VITESSE )
Lors des observations depuis la surface de la Terre d'objets anormaux situés à une grande distance, lorsque la vision binoculaire ne permet plus de percevoir le volume de l'objet et d'en estimer la distance, et donc son altitude au-dessus de la surface de la Terre, ses dimensions et sa vitesse, des observations à l'il nu permettent de déterminer au moins des valeurs angulaires telles que l'altitude angulaire de l'objet au-dessus de l'horizon, ses mesures angulaires et sa vitesse angulaire.
Dans certains cas extrêmement rares, on a réussi à donner une estimation des
valeurs linéaires.
C'est devenu possible lors d'observations proches ( dans les limites de la
vision binoculaire ) ainsi que dans les cas où les objets observés peuvent
être comparés à des objets connus ou à des phénomènes situés à des distances
connues ( par exemple : on observe un objet sur le fond des montagnes, au
dessous des nuages, etc...).
Des données sur la distance peuvent également être obtenues en analysant des cas
d'observation simultanée d'objets en différents points.
Dans ces cas, on peut faire une estimation des valeurs linéaires ( altitude,
dimension, vitesse de l'objet ) si on connaît les valeurs angulaires
correspondantes.
Retour au SOMMAIRE
11.1. DISTANCE
Dans l'échantillon considéré, la distance par rapport aux objets est estimée dans 20 cas, parmi ceux-ci dans la majorité des cas, les estimations faites sont tout à fait arbitraires.
Les valeurs chiffrées de la distance, selon ces estimations, sont les suivantes :
| - 100 m... | 3 cas |
| - de 100 m à 1 km... | 2 cas |
| - de 1 km à 10 km... | 11 cas |
| - de 10 km à 100 km... | 3 cas |
| - 230 km... | 1 cas |
Cette dernière valeur (230 km) a été obtenue par Z.S. KADIKOV à partir de l'analyse de l'observation simultanée en deux points avec recalage de la position observée de l'objet par rapport aux étoiles (OK-0075).
Retour au SOMMAIRE
11.2. DIMENSIONS LINÉAIRES DES OBJETS
Les dimensions linéaires sont estimées dans 10 cas, elles sont également en
grande part tout à fait arbitraires.
L'estimation la plus petite est 4 mètres, la plus grande 600 mètres (Z.S. KADIKOV).
La répartition pour les cas intermédiaires est la suivante :
| - de 10 m à 100 m... | 4 cas |
| - de 100 m à 300 m... | 4 cas |
Dans une série de cas, les témoins donnent une estimation tout à fait dénuée de
fondements des dimensions lin Paires pour un objet éloigné, où il n'est pas
possible de déterminer des dimensions réelles.
Ces types d'estimation ne sont pas prises en compte dans la statistique.
Retour au SOMMAIRE
11.3. ALTITUDE AU-DESSUS DE LA SURFACE DE LA TERRE
Elle est estimée dans 27 cas, y compris certaines estimations faites à bord d'un
avion.
Plus petite estimation : 35 m, plus grande : 100 km ( Z.S. KADIKOV ).
La répartition pour les cas intermédiaires est la suivante :
| - de 100 m à 1 km... | 7 cas |
| - de 1 km à 10 km... | 14 cas |
| - de 10 km à 100 km... | 3 cas |
Les données sont plus fiables sur le caractère de la variation de l'altitude.
Elles sont indiquées pour 68 cas d'observation, dont :
dans 30 cas,
l'altitude de l'objet n'a pas changédans 12 cas,
on a observé une diminution progressive de l'altitude de l'objetdans 10 cas,
l'altitude a progressivement augmentédans 6 cas,
on a observé une ascension verticale de l'objetdans 9 cas,
on a observé une descente verticaledans 1 cas,
on a observé une oscillation de l'altitude.
Retour au SOMMAIRE
11.4. VITESSE LINÉAIRE
Elle est estimée dans 10 cas.
L'estimation minimale est de 5 m/sec.
L'estimation maximale est de 5 km/sec.
Retour au SOMMAIRE
12. EFFETS & PHENOMENES ACCOMPAGNANTS
Dans une série de cas, des phénomènes atmosphériques anormaux ont une influence déterminée sur l'environnement.
Dans la plupart des cas, ils se passent apparemment sans bruit ; les témoins
ne remarquent aucun effet sonore, mais dans un nombre important de cas, ils
insistent particulièrement sur l'absence de son.
Les rares cas où le phénomène s'accompagne de son, demandent une analyse spéciale.
Ceci peut être lié aux observations d'objets non anormaux spécifiques ( par
exemple : les bolides ), soit être dus au fait que les phénomènes se
déroulent près de l'observateur ( dans ce cas, la présence de
son peut servir d'indication indirecte pour l'estimation de la distance ).
On a noté des cas d'influence sur des moyens techniques et sur le système nerveux
de l'homme.
Ces cas sont extrêmement rares.
Cependant, ils ont une signification très importante.
Il faut ici contrôler très soigneusement et stocker des données complémentaires.
Le bilan des effets accompagnants observés est présenté dans le tableau n°18.
On a indiqué entre parenthèses le numéro des cas selon le Catalogue Général
préliminaire.
| EFFETS ACCOMPAGNANTS | Nombre de cas d'observation |
| SON : | |
| . Absence de son remarquée | 63 |
| . Phénomène accompagné de son dont : bruit sourd.....1 grondement.....1 bruissement.....3 sifflement.....2 grésillement.....2 |
10 |
| MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU MILIEU : | |
| . Modification des conditions du passage du son | 1 (OK-0177) |
| . Postluminescence du ciel | 1 (OK-0198) |
| . Rafales de vent dues au mouvement de l'objet | 2 (OK-0161, 0174) |
| . Disparition des nuages près de l'objet | 2 (OK-0110, 0117) |
| INFLUENCE SUR MACHINES ET ÉQUIPEMENTS : | |
| . Perturbation de l'éclairage | 1 (OK-0061) |
| . Perturbation du fonctionnement de moteurs à explosion | 1 (OK-0253) |
| . Influence sur le fonctionnement d'équipements radio | 1 (OK-0219) |
| . Panne d'une partie électrique d'un équipement | 2 (OK-0218, 0219) |
| . Arrêt des moteurs d'un avion | 1 (OK-0061) |
| DÉTÉRIORATION MÉCANIQUE D'UN ÉQUIPEMENT | 1 (OK-0219) |
| INFLUENCE SUR LE SYSTÈME NERVEUX DE L'HOMME : | |
| . Perte provisoire de la vue | 2 (OK-0218, 0219) |
| . Etouffement (oppression) du psychisme | 3 (OK-0168, 0171, 0177) |
| . Perte de connaissance | 1 (OK-0219) |
- TABLEAU N° 18 -
Effets et phénomènes accompagnants
Retour au SOMMAIRE
13. DATES AVEC UN GRAND NOMBRE DE CAS D'OBSERVATIONS
Dans le § 5.2, on fait remarquer la présence d'observations indépendantes,
faites à la même date, à peu près au même moment en des points différents.
Dans les tableaux n°19, 20 et 21, on donne comme exemple une courte description
des observations d'objets anormaux pour trois dates de 1967.
Les objets ont été observés sur un territoire assez important.
La répartition des points d'observation est présentée dans les figures n°20, 21 et 22.
Les observations indépendantes faites en différents points sont des témoignages supplémentaires de la réalité du phénomène observé.
Par principe, on peut admettre les possibilités suivantes :
observations simultanées d'un même objet en des points différents,
observations successives d'un même objet,
observations de différents objets.
Pour choisir entre ces possibilités, il faut faire une analyse détaillée.
Il semble que certains des cas décrits correspondent à l'observation d'un seul
objet.
Si ce sont des observations simultanées, et non successives, l'altitude doit être
de l'ordre de centaines de kilomètres, et les dimensions linéaires de
l'ordre du kilomètre.
Retour au SOMMAIRE
14. CONSIDÉRATIONS
En conclusion, examinons les traits essentiels du phénomène observé ainsi que les conclusions déduites de l'analyse statistique des documents d'observation.
14.1. FIABILITÉ DES DOCUMENTS D'OBSERVATION DE BASE
On a pris comme base d'analyse les rapports écrits de témoins de phénomènes
anormaux observés par eux.
Aucune vérification des rapports d'auteur n'a été faite.
Il faut noter la part relativement peu élevée d'observations isolées dans les
deux tiers des cas, plus d'un témoin a participé aux observations.
De plus, il y a un pourcentage tout à fait important d'observations de masse.
Pour un nombre important de cas, il y a eu des observations
indépendantes, faites simultanément en des points différents.
Dans la majorité des cas, les observateurs jouissent d'une qualification assez élevée, ce qui élève aussi la fiabilité du document de base.
| N° de OK | POINT D'OBSERVATION | Heure TU | FORME | TRAJECTOIRE | Direction |
| 0224 | UKRAINE, ville de POUTIVL | 17.45 | raie avec angle | non indiquée | -- |
| 0229 | UKRAINE, région de DONETSK ville de IACINOVATAIA | 18.00 | croissant et étoile | régulière | O - E |
| 0012 | RUSSIE, Région de STAVROPOL, KRASNOGORSKAIA | 18.00 | croissant | régulière | O - E |
| 0015 | UKRAINE, région de DONETS, village : NOVO-AMROSEVSKI | 18.15 | croissant asymétrique corps sombre, étoile | régulière avec virage sur un angle faible | O - E |
| 0013 | RUSSIE, région de STAVROPOL ville : NEVINOMISK | 18.15 | croissant | régulière | SO - NE |
| 0222 | UKRAINE, région de VOROCHILOVGRAD ville : KRASNY LOUTCH | 18.15 | croissant se transformant en étoile | non indiquée | SO - E |
| 0226 | RUSSIE, région de KRASNODAR village : LAZOREVSKAIA | 18.20 | croissant demi-disque | régulière | ? - NE |
| 0014 | UKRAINE, région de VOROCHILOVGRAD Ville : MALODOGVARDEISK | 18.30 | croissant et 2 étoiles | régulière | SO - NE |
| 0221 | UKRAINE, région de DONETS ville : JDANOV | 18.30 | croissant symétrique | régulière | SO - NE |
| 0010 | GEORGIE, ville de AGOUDZERI près de SOUKHOUMI | 19.00 | disque vue de la tranche | régulière | O - E |
- TABLEAU n° 19 -
- OBSERVATIONS DE PHÉNOMÈNES ANORMAUX DU 17.07.67 -
Retour au SOMMAIRE
| N° de OK | POINT D'OBSERVATION | Heure TU | FORME | TRAJECTOIRE | Direction |
| 0059 | UKRAINE, région de VOROCHILOVGRAD SVATOVSKI | 16.20 | croissant et étoile | régulière | SO - NE |
| 0056 | UKRAINE, région de VOROCHILOVGRAD & SERAFIMOVITCH, ferme ZILMNIK | 16.20 | corps sphérique | régulière | NO - SE |
| 0063 (a) | Vol d'avion n° 404 VORCHILOVGRAG/ VOLGOGRAD | 16.30 | croissant, puis oblong | "suspendu", manuvre/avion régulière | O - E |
| 0064 | RUSSIE, région de VOLGOGRAD - VOLTSKI | 16.30 | croissant | non indiquée | - |
| 0057 | Région de BELGOROD, NOVOOSKOLSKI | 16.40 | croissant, demi-disque puis croissant | Régulière "suspendu" | - |
| 0058 | UKRAINE, VOROCHILOVGRAD ville : SEVERODONETSK | 16.00 | croissant et étoile, puis étoile | --- | 0 - E |
| 0053 | UKRAINE, ville : DONETSK | 17.20 | croissant puis raie | régulière | S - NE |
| 0054 | UKRAINE, villa : JDANOV | 17.20 | corps sphérique | --- | S - N |
| 0061 | UKRAINE, région de DONETSK, district MARINSKI, GORKI | 17.00 | croissant et étoile | manoeuvre par rapport à un avion | - |
| 0060 | UKRAINE, région de DONETSK, ROI | 17.00 | croissant et étoile | régulière | SO - NO |
| 0062 | UKRAINE, ville de DONETSK | --- | croissant asymétrique et étoile, puis croissant se transformant en "tâche" irrégulière | régulière | O - E |
- TABLEAU n° 20 -
- OBSERVATIONS DE PHEMOMENES ANORMAUX DU 19.09.67 -
Retour au SOMMAIRE
| N° de OK | POINT D'OBSERVATION | Heure TU | FORME | TRAJECTOIRE | Direction |
| 0078 | ABKHAZIE, ville : NOVY AFON | 14.50 | corps rond (disque) | --- | --- |
| 0076 | Région de SÉBASTOPOL : PIATIGORSK | 14.59 | croissant demi-disque | régulière | --- |
| 0075 | Région de SÉBASTOPOL : PIATIGORSK | 15.00 | croissant | régulière | --- |
| 0079 | Région de STAVROPOL : RESENTOUKI | 15.00 | "irrégulière" et étoile de forme perceptible | régulière | NO - SE |
| 0077 | ABKHAZIE, ville : TKVARTCHELI | 15.05 | croissant | régulière | NO - SE |
| 0082 | VOLGOGRAD | 15.05 | croissant | 2 brusques changements | --- |
| 0080 | ROSTOV sur le DON | 15.15 | croissant et étoile | régulière | --- |
| 0022 | UKRAINE, région de VOROCHILOVGRAD ville : MOLODOGVARDEZSK | 15.45 | croissant et étoile, puis encore objet en étoile | --- | SO - NE SO - S |
| 0081 | ABKHAZIE, ville de NOVY AFON | 16.00 | croissant | régulière | NO - NE |
| 0106 | District de KRASNODAR ville : ARMAVIR | --- | croissant | régulière | --- |
- TABLEAU n° 21 -
OBSERVATIONS DE PHÉNOMÈNES ANORMAUX DU 18.10.67
Retour au SOMMAIRE
Les caractéristiques de temps, répartitions des évènements dans la journée et
selon leur durée, correspondent bien aux données de l'étranger.
Ceci témoigne de ce que nous avons affaire à une classe déterminée de phénomènes,
présentant des propriétés statistiques stables déterminées.
A ce point de vue, il est important que, conformément à VALLÉE et POHER
(Ref. 1), la répartition des évènements en durée pour des phénomènes anormaux
( non identifiés ) est fondamentalement
différente de celle des phénomènes et objets connus ( identifiés ).
Tout ceci permet d'arriver à la conclusion suivante : dans les rapports sont
décrites les observations de phénomènes réels.
S'il y a des hallucinations ou des rapports erronés, leur pourcentage n'est pas
important car ils influent peu sur les propriétés statistiques de l'échantillon
choisi.
Retour au SOMMAIRE
14.2. CARACTÉRISTIQUES D'OBSERVATION DU PHÉNOMÈNE
La répartition spatiale du phénomène englobe tout le territoire d'URSS.
A certaines périodes, apparemment, on observe une activité plus élevée dans des régions déterminées.
En outre, les zones d'activité plus élevée varient au cours du temps.
Ceci a déjà été indiqué à l'échelle globale par SAUNDERS (Ref. 6).
Les régularités de ce processus ne sont pas encore très claires et demandent à être étudiée complémentairement.La répartition des évènements selon les mois de l'année varie apparemment également dans le temps.
En particulier, l'année 1967 est caractérisée par une asymétrie importante :
printemps / automne.La répartition au cours de la journée donne un maximum nettement marque soir vers 21 heures locales.
La courbe observée est sans doute la superposition de plusieurs effets :
la répartition vraie du phénomène les occupations journalières de la population ainsi que l'heure de la tombée de la nuit.
De toutes façons, les données que l'on a indiquent une relation avec les saisons dans la répartition observée.
Cet effet demande à être étudié plus en détails.
Il est souhaitable de faire un comparaison de l'heure d'observation du phénomène avec l'heure de la tombée de la nuit.
La répartition selon l'heure sidérale locale révèle un maximum secondaire décalé du premier d'environ 6 heures.
La réalité de ce fait reste à vérifier à partir d'une documentation statistique plus large.Les formes observées des objets anormaux sont extrêmement variées.
Ceci peut s'expliquer soit par une diversité du phénomène lui-même, soit par le fait que nous avons affaire à des phénomènes de nature différente.
Peut être que les deux facteurs existent.
Il faut remarquer la part importante d'objets en forme de croissant qui sont d'habitude tout à fait rares.
Ceci est lié aux particularités de l'année 1967 qui est d'un apport fondamental dans l'échantillon considéré.La durée moyenne du phénomène est de l'ordre de quelques minutes.
Cependant, des types d'objets différents sont caractérisés par une durée différente.
Ainsi parmi les objets en croissant, une part importante présente une durée de l'ordre de quelques secondes, et les objets en forme "exotique" régulière ( carrés, triangles, etc...) ont une durée de l'ordre d'une heure.Dans un nombre important de cas (22,5%), on a remarqué différentes phases du phénomène, liées à une modification des constitutions de formes :
modification de la forme de l'objet ( transition d'une forme à une autre ); séparation d'un objet d'un autre jonction d'un objet à un autre ; extinction d'un objet lumineux dissipation progressive d'un objet ; apparition d'un nouvel objet, etc...Dans 94 cas sur 256 (37%), on a observé simultanément plusieurs objets.
On associe particulièrement souvent des objets de forme variable avec des objets en forme d'étoile.Pour une partie importante d'objets (168 sur 467), on a observé différents détails extérieurs :
queues lumineuses, étincelles, rayons lumineux, arcs, rayonnement autour d'objets, enveloppe de forme variable.
Pour 82 objets (18%), on a remarqué des détails "intérieurs" ( inhomogénéité de la surface, raies sombres et claires, feux, tâches lumineuses, jets ) ainsi que des détails rappelant des détails de "structure".Une majorité importante d'objets présente un corps lumineux ( apparemment "autolumineux" ), observé sur un fond de ciel sombre : cependant, dans une série de cas, l'objet a été vu sur un fond de ciel clair et brillait, vraisemblablement par lumière réfléchie.
Enfin, dans une série de cas, on a observé un objet sombre ( au total : 32 objets sombres ont été observés ).La couleur de brillance est très variable : les observateurs remarquent toutes les couleurs de l'arc en ciel du rouge au violet.
Le plus souvent, on cite : rouge, orange (feu), jaune et blanc.
Dans une série de cas, on a remarqué une couleur argentée ou une couleur de nuance métallique.
On a également remarqué des couleurs mélangées, ( par exemple : jaune/vert ) et des objets présentant une surface de plusieurs couleurs.
Dans la majorité des cas, la couleur de brillance n'a pas changé, cependant dans 23 cas, sur 184, on a remarqué une modification de la couleur.Les mesures angulaires des objets sont estimées avec une incertitude élevée.
Une partie importante des objets (94 sur 457) présente des mesures ponctuelles ( objets en étoile ).
Une part notable ( 61 objets ) a des dimensions de l'ordre de la pleine-Lune, c'est à dire de près de 30'.
Une petite partie ( 16 objets ) est plus grande qu'un degré.La vitesse angulaire des objets, selon les estimations des observateurs est comprise entre 1°/min et 20°/s.
Dans la majorité des cas, le mouvement est régulier.
Cependant, dans 36 cas ( pour 65 objets ), on remarque une irrégularité de mouvement, une fois ou plusieurs fois, un changement de la vitesse, des mouvements par à-coup.
De plus, dans 18 cas ( pour 21 objets ), on souligne un changement brutal de la vitesse.Les trajectoires sont en général régulières.
Cependant, pour 122 objets ( 30 % du nombre total d'objets dont la trajectoire est indiquée ), on a noté des particularités importantes : brusque changement de direction, stationnaire en "suspension", manuvres des objets, rotation, trajectoires inhabituelles ( balancement, spirales, sinusoïdes, contour d'obstacles, etc...).Dans les directions du vol des objets, on remarque une asymétrie manifeste : il y a prédominance de mouvements vers l'Est.
Ces particularités sont également inhérentes surtout à 1961.
La répartition en directions, pour les autres années, sauf 1967, est assez symétrique.Les données sur les paramètres linéaires des objets ne sont absolument pas fiables.
La distance minimale, selon les estimations des témoins est de 100 m, l'altitude minimale de 35 m.
Certains cas, peuvent être classés dans les observations proches étant donné des indications indirectes où l'observateur distingue des détails à l'il nu, éprouve certains effets, ou parfois observe un objet sombre dans la nuit.Les dimensions linéaires des objets sont estimées de 4 à 600 m.
A partir de l'analyse d'observations simultanées faites en des points diffèrent, on peut estimer l'altitude de vol à quelques centaines de km, et les dimensions linéaires à environ 1 km.La vitesse linéaire est estimée entre 5 m/s et 5 km/s.
Dans la majorité des cas, les phénomènes anormaux se déroulent apparemment sans bruit.
On a remarqué des cas d'influence sur des moyens techniques et sur le système nerveux de l'homme.
Ces cas sont extrêmement rares. Mais, ils ont une signification très importante.
Il est nécessaire de vérifier ceci soigneusement et de stocker d'autres données.
Retour au SOMMAIRE
14.3. NATURE DES OBJETS ET ÉTUDES ULTÉRIEURES
A partir des données que l'on a, il n'est pas possible d'avoir une conclusion
sur la nature des phénomènes observés.
Peut-être que certains d'entre eux peuvent être appelés effets d'optique
atmosphérique.
Cependant, dans la grande majorité des cas, ils sont apparemment d'une toute autre
nature.
Ceci se voit en particulier au grand pourcentage d'observations indépendantes faites
simultanément en différents points distants de centaines de kilomètres.
Une certaine partie des observations peut être due à différentes expériences
techniques dans l'atmosphère et dans l'espace cosmique proche de la Terre.
Cependant, les caractéristiques cinématiques excluent la possibilité d'une telle
explication au moins pour un tiers des cas.
Une telle explication ne correspond pas non plus aux données sur la forme des
objets et à d'autres particularités mentionnées ci-dessus.
Enfin, il faut pendre en considération le fait qu'il existe des observations datant
de bien avant 1957, c'est à dire avant le début de l'ère cosmique.
Apparemment, la question de la nature des phénomènes anormaux reste jusqu'à présent ouverte.
Pour obtenir des conclusions plus précises, il faut disposer de données fiables.
Les rapports sur les observations de phénomènes anormaux doivent être bien
documentés.
Il est nécessaire d'organiser une collecte de ces rapports par le réseau existant
de stations d'observations astronomiques, géophysiques et météorologiques, ainsi
que par d'autres voies de service.
On doit prévoir un mécanisme de vérification des rapports que l'on obtient, aussi bien du point de vue de leur conformité avec des phénomènes réellement observés que de celui de l'établissement de la nature possible du phénomène ( phénomènes astronomiques et géophysiques ou expériences techniques dans l'atmosphère et dans l'espace cosmique proche de la Terre ).
Il est nécessaire de réfléchir soigneusement à la question d'une organisation d'observations avec des instruments spéciaux.
A notre avis, le stockage actuel des données soviétiques et étrangères justifie l'organisation de telle études.
On propose de poursuivre l'analyse statistique des documents que l'on possède, ainsi que d'étudier les paramètres physiques des phénomènes anormaux.
Retour au SOMMAIRE
FIGURES

Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 2 -
Points d'observation, partie asiatique d'URSS.
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 3 -
Répartition bidimensionnelle du nombre de cas selon la latitude et la longitude. on représente de façon approximative les contours des frontières d'U.R.S.S.
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 4 -
Répartition du nombre de cas en longitude
(*) Pour la définition de la "redondance" des rapports
d'observation par rapport aux phénomènes, voir en 5.2.
Pour la signification graphique, se reporter à l'encadré ci-contre (NDG).
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 5 -
Répartition du nombre de cas en latitude
 |
- Nombre de raports redondants sur des cas déjà cités dans un rapport |
| - Nombre de cas |
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 6 -
Répartition du nombre de cas selon les années
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 7 -
Répartition du nombre de cas selon les mois pour l'ensemble de l'échantillon
(*) signification de la redondance, voir en 5.2. et les figures 4 et 5.
Retour au SOMMAIRE

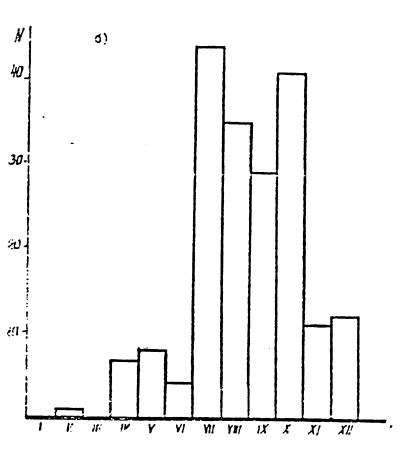
- FIGURE N° 8 -
Répartition du nombre de cas selon les mois :
- a) pour toutes les années sauf 1967
- b) pour 1967
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 9 -
Répartition du nombre de cas selon les jours de l'année 1967
Trait plein : date indiquée précisément
Trait pointillé : date indiquée approximativement
Retour au SOMMAIRE
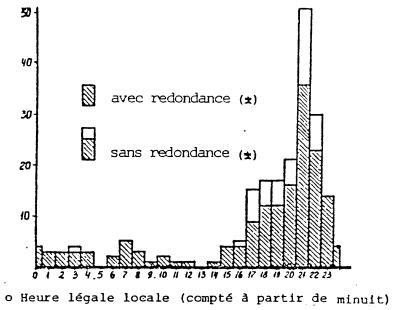

- FIGURE N° 10 -
Répartition du nombre de cas au cours de la journée
(*) Signification de la redondance : voir § 5.2. et figures 4 & 5.
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE N° 11 -
Répartition du nombre de cas au cours de la journée -
comparaison avec des données de l'étranger
Retour au SOMMAIRE



- FIGURE N° 12 -
Répartition du nombre de cas au cours de la journée pour différentes
Retour au SOMMAIRE


- FIGURE N° 13 -
Répartition du nombre de cas au cours de la journée, heure sidérale locale
- a) pour tout l'échantillon
- b) sans l'année 1967
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE n° 14 -
Répartition du nombre de cas selon l'heure de la journée (en TU)
(*)Signification de la redondance, voir § 5.2. et figures 4 & 5.
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE n° 15 -
Répartition du nombre d'évènements selon leur durée
Retour au SOMMAIRE
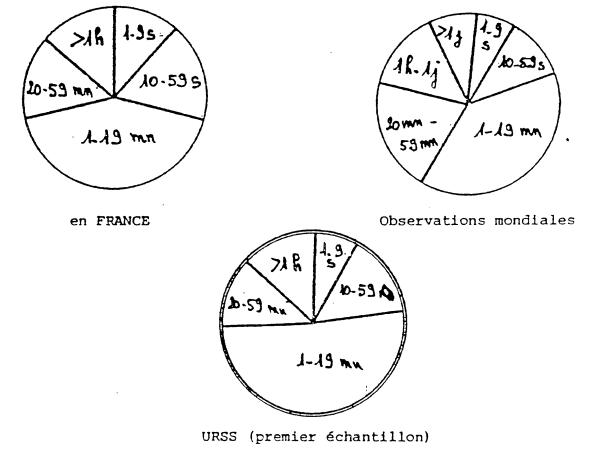
| DURÉE D'OBSERVATION | RAPPORTS | ||
| Français (1) | Mondiaux (2) | URSS (3) | |
| 1 à 9 s | 13 | 7 | 8 |
| 10 à 59 s | 18 | 12 | 15 |
| 1 à 19 min | 43 | 39 | 51 |
| 20 à 59 min | 14 | 20 | 13 |
| 1 h à 1 jour | 12 | 14 | 13 |
| plus d'un jour | --- | 8 | --- |
- FIGURE n° 16 -
RÉPARTITION DU NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS EN DURÉE, COMPARAISON AVEC DONNÉES ÉTRANGÈRES
(1) % de 135 cas.
(2) % de 375 cas.
(3) % de 114 cas
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE n° 17 -
Répartition du nombre d'objets selon la durée d'observation pour
les différents types d'objets
N - nombre d'objets
Retour au SOMMAIRE



- FIGURE n° 18 -
Répartition selon la direction du mouvement :
a) nombre de cas tenant compte uniquement des cas d'éloignement des objets dans 1
seule direction
b)nombre d'objets tenant compte de tous les objets s'éloignant
Retour au SOMMAIRE



- FIGURE n° 19 -
Répartition selon les directions du mouvement pour des objets de types différents (1967)
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE n° 20 -
Points d'observation du 17.07.67
Le nombre à 4 chiffres désigne le numéro du cas selon le Catalogue Général.
On indique l'heure TU du début de l'observation et la direction de l'éloignement ( selon les indications de l'observateur ).
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE n° 21 -
Points d'observation du 19.09.67
Le nombre à 4 chiffres désigne le numéro du cas selon le Catalogue Général.
On indique l'heure TU du début de l'observation et la direction de l'éloignement ( selon les indications de l'observateur ).
Retour au SOMMAIRE

- FIGURE n° 22 -
Points d'observation du 18.10.67
Le nombre à 4 chiffres désigne le numéro du cas selon le Catalogue Général.
On indique l'heure TU du début de l'observation et la direction de l'éloignement ( selon les indications de l'observateur ).
Retour au SOMMAIRE
BIBLIOGRAPHIE
REF. 1 - C . POHER, J . VALLÉE
Basic patterns in UFO observations
AIAA 13th Aerospace Science Meeting, Pasadena, Calif. 1975 January 20-22REF. 2 - Bilan de recensement de l'Union, 1970 - Tome Y.M., "Statistique" - 1973
REF. 3 - Grande encyclopédie soviétique Ed. 2, Annuaire 1967 M.,"Encyclopédie soviétique" - 1968
REF. 4 - J. A. HYNEK
Science - 1966, 154 - October 21, 329REF. 5 - V.J.B. OLMOS,
Are UFO sightings related to population ?
Proceedings of the 1976 CUFOS Conference
Center for UFO Studies, Evanston, Illinois, 1976, 16REF. 6 - D. R. SAUNDERS
A spatio-temporal invariant for major UFO waves.
Proceedings of the 1976 CUFOS Conference
Center for UFO Studies, Evanston, Illinois, 1976, 232
Retour au SOMMAIRE
© CNES